HISTOIRE DE SAVENNIERES
- Accueil
- Origine de Savennieres
- Histoire
- Développement
- Les Evènements et les Hommes
- Suite des Evènements
- Militaire
- Religieux
- Presbytère
- A Propos
 A VOIR : LA POSSONNIERE- ÉPIRÉ - LA ROCHE-AUX-MOINES - BÉHUARD - LOMBARDIERESDIAPORAMA
A VOIR : LA POSSONNIERE- ÉPIRÉ - LA ROCHE-AUX-MOINES - BÉHUARD - LOMBARDIERESDIAPORAMA

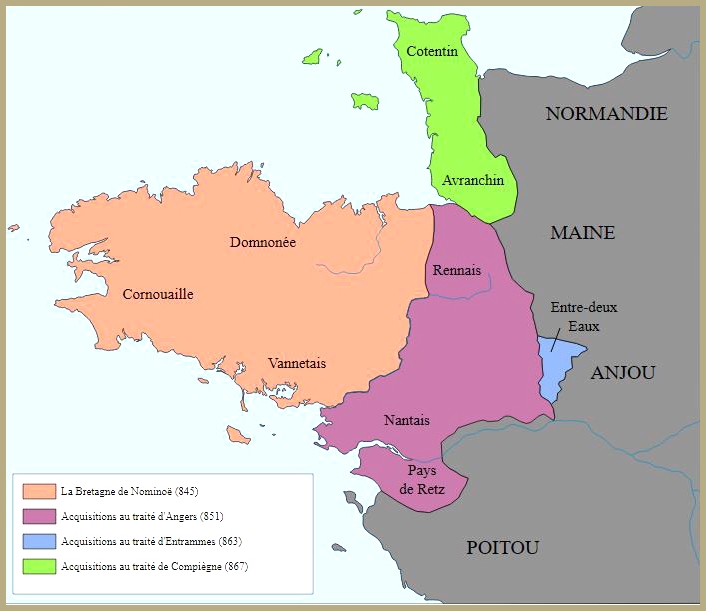
Le Comte LAMBERT à Savennières, en Bretagne
Le texte qui suit est tiré de l'édition Merle, Paris, Picard, 1896. C'est la traduction française de Pierre Le Baud vers la fin du XVe siècle.
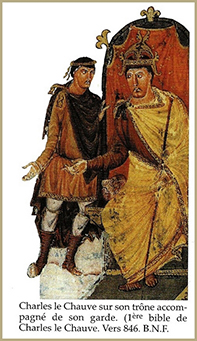 La Chronique de Nantes rapporte, après s'être longuement penchée sur les rapports entre Nominoé, Charles le Chauve et le comte Lambert et lors l'evesque Actardus alla au roy Charles et luy remontra les maux que Lambert faisoit à luy et aux citoyens de Nantes. Sur laquelle complainte ledit Charles print conseil, et manda par celui mesme Actardus à Nemenoius, prince des Bretons, par l'aide et confiance duquel Lambert avoit occupé le droict de la cité de Nantes, que, s'il le mettoit hors il luy pardonneroit toutes les offences qu'il luy avoit faites.
La Chronique de Nantes rapporte, après s'être longuement penchée sur les rapports entre Nominoé, Charles le Chauve et le comte Lambert et lors l'evesque Actardus alla au roy Charles et luy remontra les maux que Lambert faisoit à luy et aux citoyens de Nantes. Sur laquelle complainte ledit Charles print conseil, et manda par celui mesme Actardus à Nemenoius, prince des Bretons, par l'aide et confiance duquel Lambert avoit occupé le droict de la cité de Nantes, que, s'il le mettoit hors il luy pardonneroit toutes les offences qu'il luy avoit faites.
Et à celles choses adjousta l'évesque Actardus de sa part que si Nemenoius n'obeissoit audit Charles en débourtant Lambert, lesdits Charles et Lambert feroient paix ensemble, et luy seroient tous deux contraires. Laquelle chose oye par Nominoius, combien qu'il craignist peu les menaces dudit Charles, toutefois pour ce qu'il fut reprins par ses gens, il manda à Lambert que s'il ne se departoit de la comté de Nantes, il luy courroit sus par armes. Si fut Lambert espouvanté de ces mandemens, et s'enfuit à Craon, une ville qui lors estoit du territoire de Nantes, y appartenant par le droict de saint Clément, un monastère de la cité auquel la soeur d'iceluy Lambert nommée Doda présidoit .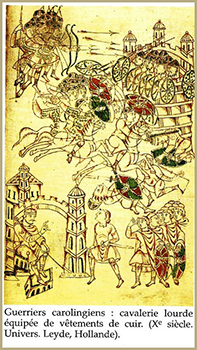
Et de la fist Lambert maints assauts aux régions voisines contre lequel plusieurs s'eslevèrent, qui s'en retournèrent desconfits. Et entre autres, Guy, comte du Maine, espérant le vaincre, l'assaillit avecques grand nombres de chevaliers qu'il mist en fuite. Et, quand il eut ainsi vaincu ses résistants, il composa un chastel sur la rive d'Udon ; et, prenant de là en après en sa domination le territoire d'Angers, si comme Mayenne descendant en Loire, le tint par sa puissance jusqu'à la fin de sa vie. Mais, comme, après ce que Lambert eut esté trop voluntaire de parolle et d'oeuvre, et aussi de son Glayve, jamais n'esut cessé d'espandre sang humain et eust fait innumbrables maulx en terre, en la parfin il fut occupé de mort subite, et finit sa vie temporelle. Si fut enseveli près de Saponarias, une ville de la comté d'Angeou.
Cette chronique a été écrite dans les milieux ecclésiastiques vers le XIe siècle. C'est dire si ce texte n'est pas une source crédible. Cependant, il relate des événements et des personnages dont le souvenir se serait effacé sans cette chronique.
La chronologie n'y est pas souvent respectée et les confusions entre Lambert comte de Nantes et son probable fils Lambert y sont patentes. La Chronique relate donc une séquence, pour le moins confusément, de la mort à Savennières de Lambert II, comte d'Anjou, et probablement de la Marche de Bretagne, allié inconstant de Charles le Chauve et de Nominé de Bretagne.
Les expéditions de Charles en Bretagne et les traités successifs entre Bretons et Francs montrent que la porosité de la frontière entre royaumes Franc et Breton est alimentée par les ambitions des grands.
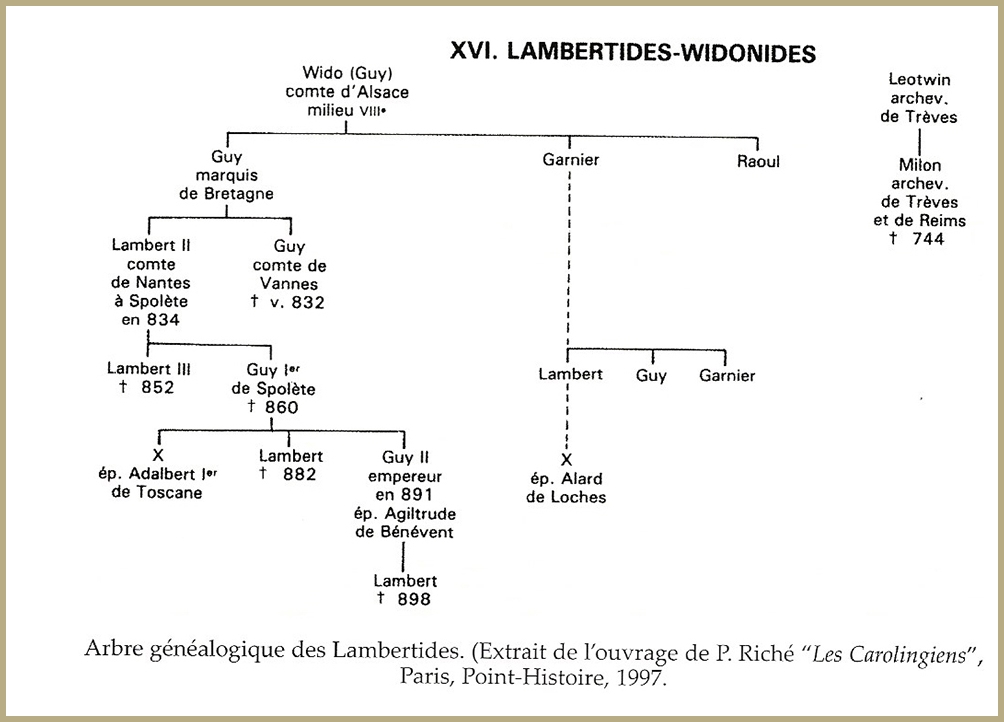
Lambert II, dont le probable père avait perdu le contrôle du comté de Nantes et s'était réfugié en Italie, n'aura de cesse de rétablir son pouvoir, s'obligeant ainsi, au gré des succès des armes, à traiter avec Bretons ou Francs.
Il ne faut pas oublier le rôle moins visible mais bien réel des Normands dans cette période. Ils interviennent soit à leur propre initiative, soit comme alliés des Francs ou des Bretons.
Ce qui nous intéresse dans ce texte est l'arrivée de Lambert II à Savennières et sa mort. Si la Chronique de Nantes est peu explicite sur ces points, d'autres textes, plus parcellaires mais plus contemporains des faits, nous apportent quelques éclairages. En 852, Lambert passe plutôt du côté des Francs et se réfugie d'abord à Craon, dans le pagus des Andes et non dans celui des Namnètes où sa soeur occupe une position dominante.
![]()
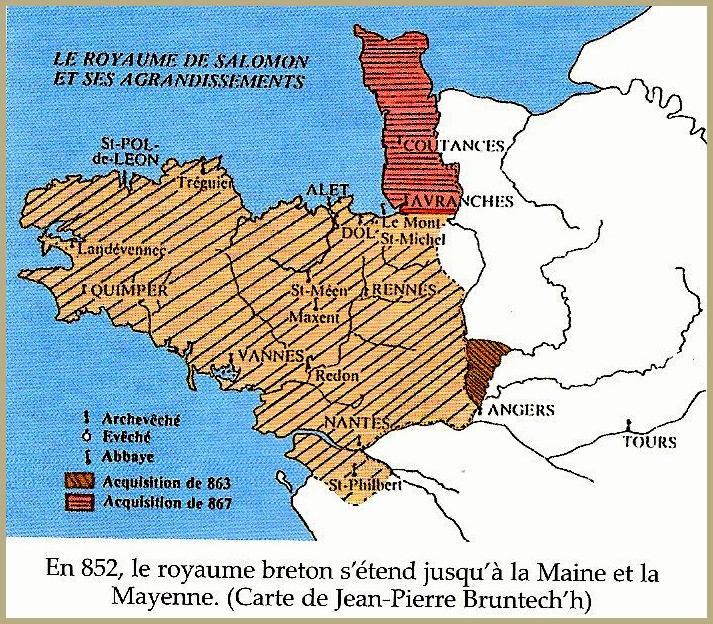
Il fortifierait le site, puis, peut-être, sous la pression des Bretons, va se rendre à Savennières. Si l'on en croit la Chronique de Nantes, il suivrait le cours de l'Oudon, puis de la Mayenne et enfin de la Loire. Ce serait un voyage fluvial, beaucoup plus long, mais peut-être plus sûr que la voie terrestre. Il ne s'agit pas d'une originalité, ce moyen de communication était assez usuel Par contre, Charles le Chauve, dans ses déplacements vers la Bretagne, utilise l'ancienne voie romaine vers Rennes et sa bifurcation vers Carhaix. Sa situation n'est certainement pas claire puisque Gausbert-le-Jeune, fils du comte du Maine, va l'assassiner pour plaire à Charles le Chauve.
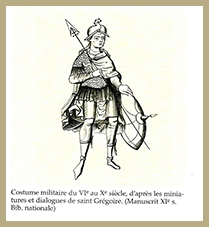 Or Gausbert-le-Jeune va être livré à Charles qui le fera décapiter pour ce crime. Cynisme Pour se débarrasser de deux ambitieux ou goût de la justice ? L'arrivée de Lambert II à Savennières ne saurait être fortuite. Cela suppose que le territoire soit dans la mouvance de Lambert et qu'il y avait une domus compatible avec son rang et pouvant héberger sa suite, notamment ses milites. Savennières est, depuis 851, aux mains des Bretons d'Erispoé puis de Salomon, la marcha sive comitatus Nanneticus va jusqu'à la Mayenne et la Maine . C'est ce qui ressort du Cartulaire Noir de l'abbaye Saint-Aubin d'Angers. Si donc le territoire se trouve sous domination bretonne, il reste dans le diocèse d'Angers. Le comitatus et l'episcopatus ne coïncident pas, comme l'a démontré J. P. Brunterc'h dans sa thèse sur Renaud d'Herbauges. La domination bretonne de Savennières se terminera au début du Xe siècle. Par contre, la situation dans le diocèse et le pagus d'Angers est confirmée par deux passages de la vita sancti Maurillii évêque d'Angers, dont les deux versions sont écrites en 905 et l'autre vers 920.
Or Gausbert-le-Jeune va être livré à Charles qui le fera décapiter pour ce crime. Cynisme Pour se débarrasser de deux ambitieux ou goût de la justice ? L'arrivée de Lambert II à Savennières ne saurait être fortuite. Cela suppose que le territoire soit dans la mouvance de Lambert et qu'il y avait une domus compatible avec son rang et pouvant héberger sa suite, notamment ses milites. Savennières est, depuis 851, aux mains des Bretons d'Erispoé puis de Salomon, la marcha sive comitatus Nanneticus va jusqu'à la Mayenne et la Maine . C'est ce qui ressort du Cartulaire Noir de l'abbaye Saint-Aubin d'Angers. Si donc le territoire se trouve sous domination bretonne, il reste dans le diocèse d'Angers. Le comitatus et l'episcopatus ne coïncident pas, comme l'a démontré J. P. Brunterc'h dans sa thèse sur Renaud d'Herbauges. La domination bretonne de Savennières se terminera au début du Xe siècle. Par contre, la situation dans le diocèse et le pagus d'Angers est confirmée par deux passages de la vita sancti Maurillii évêque d'Angers, dont les deux versions sont écrites en 905 et l'autre vers 920.
C'est déjà un lieu d'habitation relativement important pour être cité dans des textes. Un second indice de cette importance peut-être tiré de la toponymie. Il existe sur l'ancienne paroisse de Savennières (actuellement sur la commune de La Possonnière) un toponyme Verdun. Ce toponyme existe sous l'Ancien Régime et ne saurait être mis en relation avec la bataille de Verdun du début du XXe siècle. Il est caractéristique d'un site défensif du Haut Moyen Âge.
Un toponyme La Guerche existe à Savennières. Ce nom est fréquent en Bretagne, mais rare en Anjou (il y en existe trois). Il désigne des fortifications érigées par les Francs, proches des voies d'eau et destinées à la défense contre les incursions des Bretons et des Normands. Savennières jouait donc un rôle de frontière défensive, ce qui supposait une présence d'hommes d'armes et de détenteurs du pouvoir. Peut-être faut-il voir dans La Guerche le souvenir de l'habitat de Lambert, habitat dont le rôle devait être avant tout de défense. L'habitat de résidence sans rôle militaire n'est pas envisageable à cette époque en dehors des villes. Lambert, dont la situation était incertaine, ce que démontrent ses déplacements depuis Craon, ne pouvait probablement pas résider dans un lieu ouvert. Son assassinat par Gausbert montre à l'évidence qu'une telle précaution n'était pas superflue. En sus des toponymes en "é" qui peuvent se rapprocher d'une occupation gallo-romaine, le territoire ancien de Savennières recouvrait l'ancien domaine d'Andillé, dépendance d'Iohannis villa appartenant à la puissante abbaye de Saint-Florent et ancien domaine du fisc carolingien.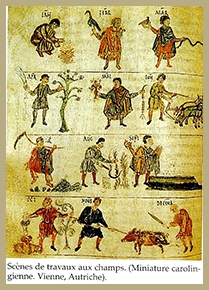
Les récentes fouilles menées par le service archéologique du Conseil général de Maine-et-Loire ont montré l'existence d'une église plus ancienne que celle dont il reste les murs sud et ouest. Cela confirme aussi l'existence d'une paroisse précoce et donc d'un peuplement groupé. Les découvertes de sépultures à Savennières datables de l'époque carolingienne, voire mérovingienne, montrent l'existence d'une structure sociale propre à l'habitat groupé à une époque où l'habitat éclaté, comme le souligne si bien Daniel Pichot, était largement de mise. La protection du territoire saponarien était aussi assurée sur sa bordure nord par l'importante forêt des Echats. Les zones forestières sont durant le haut Moyen Âge des lieux de dangers et d'incertitudes qui marquent des limites difficilement franchissables.
Ce sont des lieux de peur qu'évitent autant que possible les sociétés organisées, domaines des individus peu fréquentables et des angoisses comme le rapportent les légendes, elles sont des protections pour ceux qui vivent de l'autre côté. La voie romaine vers Nantes est située au nord de la forêt, encore utilisée. Savennières en est séparée par cette forêt qui forme un large obstacle. La Loire au sud jouait aussi un rôle de protection et de danger. C'est bien contre ceux-ci que les guerches avaient été érigées. Les envahisseurs bretons ou normands avaient facilité, par la peur qu'ils créaient, l'émergence de structures de défense. Ces remarques expliquent la présence dans le refuge de Savennières du comte Lambert, puissant en déshérence.
Mais, en l'état actuel des fouilles, il n'est pas possible de retrouver la trace de la sépulture de Lambert. On peut cependant émettre l'hypothèse d'une inhumation proche de l'église et peut-être de l'autel, comme cela devenait de coutume. Le mort, dans le choeur où était célébré le mystère de la Résurrection, bénéficiait ainsi des prières et des bienfaits de la communauté chrétienne. Le comte Lambert II fut tué par Gauzbert le Jeunet
Michel Pécha
Source : histoire des coteaux de Loire et de Maine
Bibliographie de Lambert
? 831 : après la destitution et l’exil en Italie de son père Lambert Ier de Nantes, partisan de Lothaire Ier, Lambert qui, selon la Chronique de Nantes, avait été élevé parmi les Bretons, demeure dans le Nantais avec son frère Garnier.
? 841 : Lambert combat avec le comte Ricuin de Nantes qui était peut-être devenu son beau-père dans les rangs de l’armée de Charles le Chauve à la bataille de Fontenoy-en-Puisaye le 25 juin 841. Ricuin, ayant été tué, le comte de Nantes que Lambert considérait comme son légitime héritage, est confié par le roi Charles à Renaud, comte d’Herbauge. Lambert abandonne le parti du Roi et rejoint Nominoë.
? 843 : Renaud de Nantes bat Lambert de Nantes allié aux Bretons de Nominoé et aux Vikings d’Hasting à la bataille de Messac, mais peu après, il est battu et tué à Blain le 24 mai 843. Les Nantais refusent de reconnaitre Lambert comme comte. Ce dernier est soupçonné d’avoir guidé les Normands qui, le 24 juin, mettent la ville à sac et tuent l’évêque dans sa cathédrale. Après le départ de ses alliés, Lambert ,se rend enfin maître de Nantes.
? 844 : Lambert tue dans un combat le comte Bernard de Poitiers et le fils et successeur de Renaud : Hervé comte d’Herbauge
? 845 : Fin octobre, début novembre, Lambert abandonne le parti de Nominoë et fait sa soumission au roi qui lui laisse le comté de Nantes.
? 846 : Au mois d’août, Lambert est écarté du Nantais et pourvu par le roi Charles de l’abbatial laïc de Saint-Colombe de Sens. Charles le Chauve tente d’imposer un certain Amaury comme comte de Nantes (846-849).
? 849 : Charles le Chauve rappelle Lambert et lui confie le Nantais, le Rennais et le territoire au sud de la Loire.
? 850 : Après le 15 août, Nominoë et son allié Lambert, qui avait fait une nouvelle fois défection au roi, occupent Rennes et Nantes et démantèlent les murs des deux cités pour éviter un retour des forces royales.
? 851 : Lambert accompagne Nominoë dans son offensive en Neustrie. Après la mort subite du chef breton à Vendôme le 7 mars 851, Lambert prend le commandement de l’armée bretonne en retraite. Il participe ensuite aux côtés d’Erispoë, fils de Nominoë et nouveau chef des Bretons à la bataille de Jengland près du Grand-Fougeray, où les troupes de Charles le Chauve sont écrasées le 22 août. Avant la fin de l’année, un accord est conclu entre Charles le Chauve et Erispoë, ce dernier obtient le titre royal et la cession définitive de l’ancienne Marche de Bretagne avec Rennes et Nantes. Lambert perd tout espoir de s’implanter dans la région.
La Marche de Bretagne
Se composait de plusieurs comtés réunis : le comté Rennais, le comté Nantais et le comté Vannetais, ainsi que d'une partie du Maine. Il s'agit d'une zone de défense, sous administration militaire. Son plus célèbre préfet fut Roland, que la légende a fait neveu de Charlemagne, mort en 778 à Roncevaux.
? 852 : Lambert, dont la sœur Dova était abbesse de Saint-Clément à Nantes et aussi à Craon, tente de se tailler un domaine entre le bas Maine et l’Anjou, mais il est tué le 1er mai 852 dans une embuscade par un Rorgonides, Gauzbert "le Jeunet", qui s’inquiétait de ses progrès dans le patrimoine de sa famille.
Source : La légende des Comtes d’Anjou par G.DESPINAY

Gauzbert le Jeunet
Le Maine est une ancienne province française située au nord-ouest de la France, sur la frontière de la Bretagne. Il a comme capitale Le Mans. Le Maine est riche de son histoire. Connu pour son passé tumultueux, l’endroit fut sacré région historique. À partir du IXe siècle, à l’époque carolingienne, le Maine s’érigea en comté, soit un domaine qui conférait le titre de comte du royaume de France.
Lignées et Successions
De 832 à 1062, deux familles se sont succédé à la tête du comté du Maine. Il s’agit des Rorgonides et des Hugonides. Les premiers ont représenté la principale maison du Maine. À ce titre, le comte Rorgon 1er, gendre de Charlemagne, fut le premier à endosser cette responsabilité. Avant de devenir comte du Maine de 832 à 839, Louis 1er Le Pieux lui avait confié le comté de Rennes en 819.
Après le décès de Rorgon 1er, ce fut à Gauzbert le Jeune, son neveu, de prendre en charge le gouvernement et la défense du comté du Maine.
Il fut donc à la tête des batailles menées contre les Vikings à partir de 839 à 851. Ensuite, son fils Gauzbert le Jeunet prit sa place et fut exécuté en 853. Rorgon II, trop jeune pour succéder à son père à sa mort, le gouvernement fut confié à Gauzbert le Jeune. Ce n’est qu’en 853 jusqu’en 865 que Rorgon II reçut le titre de comte du Maine. Quand Rorgon II mourut, son frère cadet Gauzfrid prit sa place. Gauzfrid était comte et à la fois marquis de Neustrie. Cela fut ainsi jusqu’en 878 où il mourut.
Après cela, notamment en 878, Ragenold accéda au trône comtal, il est un Rorgonide de branche cadette. Il se fait assassiner en 885 pour céder la place à Roger de la famille Hugonide. Ce dernier, marié à une Carolingienne veuve, succéda à Ragenold de 886 à 893 et de 895 à 900 après Gauzlin II.
Gauzbert le JeunetTue Lambert II dans une embuscade, le 1er mai 852 et fait exécuter son frère Garnier. En mars 853, Charles le Chauve accuse Gauzbert d'alliance avec les Bretons, alors en révolte, et le fait décapiter (decollatus). Cette exécution, qui était le châtiment réservé aux traîtres, incite certains Grands du royaume à se révolter et à appeler à l'aide Louis le Germanique. Selon la Chronique de Saint-Maixent, Gauzbert est tué par les Nantais. On ne sait pas s'il se maria, ni s'il eut des enfants. C'est Rorgon II qui lui succéda.
Source : Doyenné de Candé par Michel PECHA
Oger BARDOUL
Savennières, qui était occupé depuis de nombreuses années, est au début du XIe siècle la possession de laïcs comme Oger BARDOUL, Une notice du Cartulaire, de Saint-Serge et Saint-Bach éclaire en partie cette question. Cartulaire Saint-Serge : entre 1056-1082, Oger Bardoul de Champtocé et Durand Brunel de Montjean vendent aux moines les églises Saint-Pierre, Saint Jean-le-Baptiste et saint Romain de Savennières en 780.
Ils ajoutent à la vente un terrain autour de l’église paroissiale Saint-Pierre pour que l’abbaye puisse y construire un four, des granges, un hôpital et tout ce qui serait nécessaire à l’apostolat des moines. Cette énumération ne reprend pas le mot de cimetière, mais il est précisé que les moines acquièrent le droit de sépulture en présence de dix-huit témoins.
La notice indiquant explicitement que l’espace déterminé pour être réservé aux moines ne devait pas être construit ou habité, il est possible que le cimetière ait été circonscrit à l’enceinte confiée aux moines lors du transfert de la propriété des terres et des droits.

Cartulaire Saint-Serge
À la fin du XIe siècle, Geoffroy et ses fils contestent aux moines une terre à Andillé, la terre revient finalement aux moines avec l’assentiment de Bardoul de Champtocé, seigneur de la terre.
Fin du XIe siècle,
Soucieux de son salut et de son âme, après qu’il eut donné avec d’autres au monastère des saints martyrs Serge et Bach, l’église de Savennières en acceptant l’argent des moines, voulant offrir en aumône (elemosinam) quelque chose de ses propres biens, sans contrepartie, vint de nouveau au Chapitre des moines avec son épouse, Griscia, et donne en ce lieu toute la part des sépultures qu’il a jusqu’alors sur l’église de Savennières ; il donne aussi à Saint-Serge, après sa mort, la maison qu’il avait à Savennières et trois arpents de vignes qui après sa mort seront tenus des moines ; il le fait pour le rachat de ses péchés en même temps que pour l’âme de ses parents ; il donne aussi un manse au Plessis-Macé, mais les moines devront demander l’autorisation de ce don à Matthieu .
Sont témoins Stéphane de Gisois, Mainard clerc de Savennières, Griscia son épouse, Roland qui, en recevant le bénéfice du lieu, donne son accord aux moines pour l’amour de Dieu et des saints martyrs, pour tout ce qu’ils tiennent de son fief à Méral.
Source : : Doyenné de Candé par Michel PECHA
Liste des comtes authentiques :d'Anjou et des Marches de Bretagne
- Licinius, comte d'Anjou, sous Clotaire I
- Théodulfe, comte d'Anjou sous Gontran
- Beppolen, duc ou gouverneur des Marches, vers 587
- Rainfroy, comte d'Anjou, sous Charles Marte;
- Roland, préfet des Marches, mort en 778
- Auduif, préfet des Marches, vers 786
- Rorgon, comte du Maine et l'Anjou, en 839
- Théobald, comte, abbé de Saint-Jean-Baptiste, vers 845(?)
- Gérard, comte, abbé de Saint-Serge, sous Charles Le Chauve;
- Eudes, comte d'Anjou
- en 851 Lambert, comte de Nantes, puis gouverneur des Marches, mort en 852
- Robert le Fort Hugues l'abbé, comte et gouverneur des Marches, 867-886
- Eudes, comte et gouverneur des Marches, 886.-88
- Robert, comte et gouverneur des Marches, 888-921
- Hugues Le Blanc, comte et gouverneur des Marches,923-956;
- Foulques le Roux, fils d'lngelger vicomte de Tours et d'Angers, vers 886 comte d'Anjou, vers 929
Comtes de Bretagne ayant possédé l'Anjou d'outre-Maine
- Nominoë envahit l'Anjou en 849, meurt en 851;
- Erispoé, 851-857; Salomon, 857-874;
- Pasquiten et Gurvand;
- Judicaël et Alain le Grand : luttes intestines; invasions normandes ; anarchie en Bretagne, 874-907;
- Alain Barbetorte, 907-952
Les actes des comtes d’Anjou
Au XIe siècle, ils sont assez rares. Certains se trouvent dans les cartulaires. Olivier Guillot en a édité les plus importants dans son ouvrage au tome II. Il s’est livré à une analyse intéressante des formules de dévotion utilisées par les Ingelgériens. Il y voit une reconnaissance majeure du rôle de la providence qui l’emporte sur l’origine divine du pouvoir. C’est une forme à la fois originale et atypique en ce XIe siècle. Là encore, l’originalité du comté d’Anjou est patente.
Pour le XIIe siècle, les actes d’Henri II, le comte roi, ont fait l’objet d’une parution imprimée, publiée par L. Delisle et E. Berger à Paris entre 1909 et 1924, sous le titre Recueil des actes de Henri II, roi d’Angleterre et duc de Normandie, concernant les provinces françaises et les affaires de France. Ces actes s’intéressent assez peu au peuplement et, en général, à l’encadrement des populations.
Ils sont peu utilisables dans le cadre de notre sujet, les affaires concernées relevant de la politique générale du comté et des dominants. Pour la période antérieure, quelques diplômes carolingiens concernent le retour en des mains cléricales des biens du fisc.
Ils sont contenus ou repris dans les Cartulaires, pour ce qui les concerne. Les biens du fisc de Loiré et de Chazé sur Argos, rétrocédés par Charlemagne à l’abbaye de Prüm le 17 février 797, ont fait l’objet d’un acte publié dans Mülbacher no 180. Juigné et ses biens rétrocédés par Charles-le-Chauve à l’église d’Angers le 16 avril 872 ont été publié par Tessier no 362.
La Noblesse
Il y avait sous l'ancien régime 400 000 nobles en France, soit 1,5 % des Français, parmi lesquels on distinguait la noblesse de race ou d'épée et les anoblis, c'est-à-dire les personnages élevés à la noblesse, par la grâce du roi, pour exercer des charges militaires, administratives, financières ou judiciaires.
Ces derniers formaient la noblesse de robe. D'après la situation sociale, on distinguait donc la haute noblesse ou de Cour : princes du sang, grands seigneurs, gentilshommes vivant ou admis à la Cour comme le comte Walsch de Serrant, et la noblesse composée de magistrats avec hôtels en ville et châteaux en campagne, et les petits hobereaux.
La noblesse d'épée dédaignait la noblesse de robe, mais tous les nobles jouissaient de privilèges, soit honorifiques comme celui de porter des armoiries, d'avoir une place de choix à l'église ou de poser une girouette sur le toit de son manoir, soit d'immunités fiscales : exemption de la taille et de la corvée royale, ainsi que du logement des gens de guerre, quote-part réduite de la capitation et du vingtième, soit encore juridiques comme celui d'être jugé par un parlement pour crime et d'avoir la tête tranchée au lieu d'être pendu.
. Ils avaient aussi des privilèges féodaux de justice, de chasse, de champart (redevance en nature, sorte de dîme seigneuriale), de corvées, de péages sur les routes et les ponts, de mutations ("lods et ventes") sur les transactions foncières, de banalités sur les moulins, fours et pressoirs.
Après une forte augmentation de ses revenus au XVIIIe siècle, à la suite de la hausse des prix agricoles et des fermages, il y eut appauvrissement de la noblesse dont le train de vie dépassait les moyens. Nombreux furent les nobles qui épousèrent alors une riche bourgeoise pour redorer leur blason, d'où la "réaction nobiliaire" des grands refusant l'accès aux charges aux nouveaux anoblis.
Certains Parlements allèrent même jusqu'à exiger quatre quartiers de noblesse (4 antécédents directs nobles) pour l'attribution de certaines charges. On fit revivre alors des droits anciens, ce qui éveilla la colère et la haine dans les campagnes. L'affaire des arbres le long des chemins en Anjou en est l'exemple bien connu.

LES CHÂTEAUX de SAVENNIERES
Aiglerie
Le domaine de L'Aiglerie, aujourd'hui propriété Roussier, bien exposé au-dessus du moulin de la Petite Roche, et bien en vue entre Savennières et La Possonnière. La construction date de 1680 et non de 1660, comme l'indique, par erreur, la carte postale ci-contre.

Belle-Vue
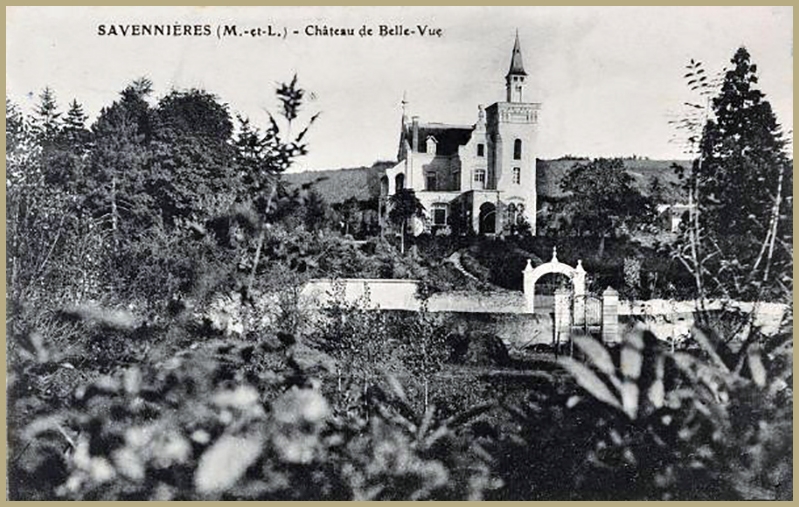
Cette plaisance, à l'architecture quelque peu prétentieuse est caractéristique des nombreuses maisons bourgeoises construites dans tout le secteur durant la seconde moitié du siècle dernier.
La qualité du site et la facilité des communications grâce au chemin de fer attirent en effet nombre de riches Angevins, et particulièrement des juristes.
La Bizolière
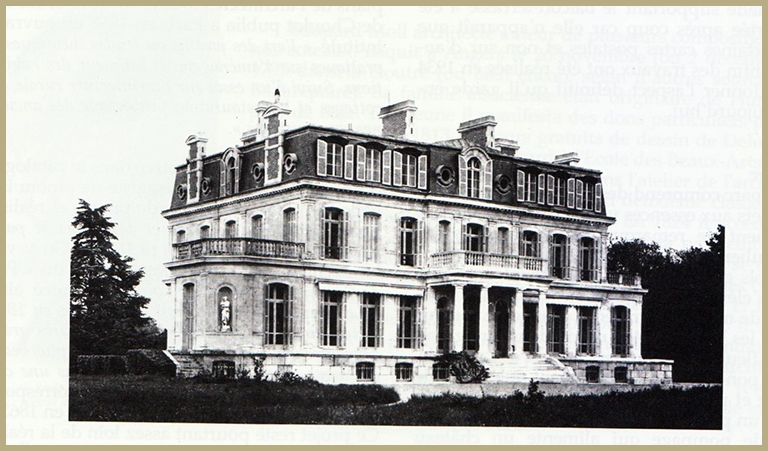
Au nord du bourg de Savennières, le long du chemin départemental 106 qui mène à Angers par Saint-Jean-de-Linières, la Bizolière se cache au milieu d'un grand parc. L'entrée principale se fait tout au sud par un portail grille qui était orné jadis de deux sphinges sur piliers, aujourd'hui disparues. L'entrée ordinaire donne à l'Ouest. Elle est gardée par un curieux pavillon en pierre noire cachant, au fond, la ferme de Malabrit. Les dépendances, comprennent dans une clairière, un hameau dit « la vieille Bizoliere » avec maison de garde habitée, orangerie et jolies écuries. Non loin se trouve un grand potager entouré de murs recouverts de treillages sur lesquels courent de vieux ceps de vigne, et une intéressante maison de campagne du XVIIIe siècle dite « la Petite Marzelle » a un étage habitable sur rez-de-chaussée de service, accessible par un joli escalier extérieur.
La propriété figure sur la carte de Cassini sous l'orthographe de la Bisoliere.
LA BIZOLIÈRE
Le toponyme date de la seconde période du Moyen Âge. À cette époque, beaucoup de petites localités et de domaines ruraux se voient attribuer comme nom de baptême celui de leur fondateur ou de leur premier propriétaire, comme à l'époque gallo-romaine. Cependant, au lieu de se terminer en -acum qui donnera -ac, -é, -y ou -ay suivant les régions (cf. Cognac, Aubigné, Orly, Agon-nay), le nom se voit ici rajouter le suffixe ière ou erie. Celui-ci est hérité du suffixe latin « aria » qui signifiait à peu près «propriété de ».
La Bizolière a donc été fondée par le sieur Bizol (ou Bize). Le patronyme dérive de l'ancien français bise (= miche de pain bis) et dénote un ancêtre boulanger ou vendeur de pain. La Bizoliere était autrefois un ancien petit domaine que les Duboys étendirent progressivement, demandant au célèbre architecte Édouard Moll d'y réaliser en 1863 une grande demeure moderne pour l'époque.
La Grande Maison Elle est d'un néoclassicisme de la seconde moitié du XIXe siècle et se présente comme un bâtiment rectangulaire, appelée communément par ses propriétaires successifs « la grande maison ». Elle est érigée sur sous-sol à demi-enterré, réserve aux services et est disposée selon les principes adoptés pour toutes les maisons de maitre de l'époque, à savoir : rez-de-chaussée légèrement surélevé et réservé aux pièces de réception, tandis que le premier étage, à droite, recoit les chambres desservies par un large et élégant escalier curviligne en pierre.
Quant aux combles dits à la Mansard, ils sont couverts en zinc et en ardoise. Les murs des façades sont en pierre apparente, mais la modénature reste sobre et donne rigueur et noblesse à l'ensemble. À l'arrière, un petit avant-corps bas sert de vestibule d'entrée. En façade principale orientée plein sud, un perron ouvre sur le parc. Il est abrité par un porche à colonnes supportant un grand balcon.
Deux ailes basses à pans coupés et couverture en terrasses bordées de balustres prolongent le corps principal. À leurs angles, des pilastres toscans, rappellent les colonnes du portique central et encadrent des niches recevant chacune une allégorie des quatre saisons.
Source Dictionnaire Célestin PORT
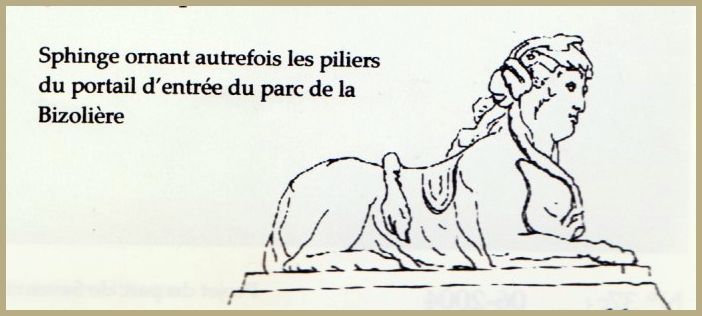
Ce bâtiment a évolué au cours des ans. La colonnade supportant le balcon-terrasse a été rapportée après coup, car elle n'apparaît que sur certaines cartes postales et non sur d'autres. Enfin, des travaux ont été réalisés en 1934 pour donner l'aspect définitif qu'il garde encore aujourd'hui.
Le parc
Comprend des prairies entourées de bosquets aux essences variées sur lesquelles se détachent de remarquables sujets isolés, en particulier des vieux chênes, des cèdres, pins parasols et séquoias. Curieusement, un chêne liège s'élève dans un bosquet à plus d'une dizaine de mètres et un cèdre change de couleur selon les saisons. Au Nord, dans un grand étang fleuri de nénuphars nagent des canards. Deux ponceaux de pierre relient une petite île boisée et permettent de la traverser.
Non loin de là, un pavillon en bois cache en fait une station de pompage qui alimente un château d'eau dissimulé dans une futaie proche du château. Dans une clairière se dressent deux hautes colonnes ioniques finement cannelées et décorées, supportant un entablement. Elles encadrent une niche abritant une naïade portant amphore. Au pied de cet "entre fenêtre" une dalle gravée porte cette inscription : « Colonnes et niche provenant des ruines du rez-de-chaussée du château des Tuileries à Paris incendié en mai 1871, transportées de Paris et reconstruites dans le parc de la Bizolière en mai 1883.» Sunt lacrymae rerum (elles sont les larmes des choses).
On dit que ce parc aurait été dessiné par le comte de Choulot, grand paysagiste angevin de la seconde moitié du XIXe siècle. Il avait dessiné entre autres le parc du château de Challain-la-Potherie pour le comte François de La Rochefoucauld-Bayers. Ce dernier château a été construit sur les plans de l'architecte Hodé entre 1848 et 1854 et de Choulot publia à Paris en 1858 un ouvrage intitulé « L'art des jardins ou études théoriques et pratiques sur l'aménagement intérieur des habitations.»
Suivi d'un essai sur l'architecture rurale, les cottages et la restauration pittoresque des anciennes constructions. Mais nous avons retrouvé dans le catalogue d'un autre architecte paysagiste de renom, Eugène Deny, une trentaine de projets et réalisations intitulés : « Plans et aquarelles de parcs paysagers exposés à Moscou en 1891 ». On y voit en dernière page une photographie du « parc de Savennières (Maine-et-Loire) » annotée ainsi : Les travaux de ce parc ont été exécutés en 1866 . Actuellement, la végétation a pris un très grand développement, et ce domaine est un des plus beaux que nous ayons été appelés à créer dans une carrière de 27 années.
La date de 1866 correspond bien à celle du château que l'on situe en 1863. Ce projet reste pourtant, assez loin de la réalité et l'on a beaucoup de mal à reconnaître l'état actuel des réalisations. Pourtant il contient bien les principaux éléments de la composition notamment le portail d'entrée et ses sphinges, le lac, l'île, le château, ses dépendances, etc. Auss,i cette perspective aquarellée n'a été dessinée, sans doute, qu'en avant-projet pour séduire le maître de l'ouvrage ou répondre à un concours d'idées lancé par ce dernier. E. Deny était officier du mérite agricole et président du Comité des Jardins de la Société nationale d'horticulture de France.
On lui doit les anciens jardins du
NPaillon à Nice. Il publia en 1893 un traité des « Jardins et parcs publics, Histoire générale des jardins, les maîtres de l'école moderne et leurs principales créations, le style paysager, exposé de ses principes et applications » où il milite pour un art nouveau des jardins après ceux dits à la française ou à l'anglaise dont il s'inspire pourtant largement.

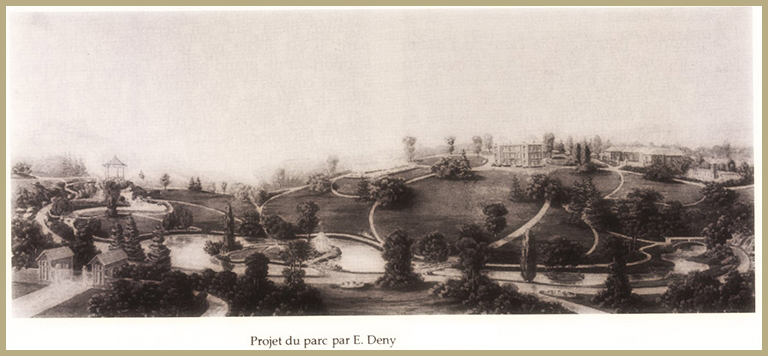
30/10/1923-décès de M. Armand Antoine Alfred de GRAMONT, propriétaire du château de la Bizolière
Source :Histoire des Coteaux de Loire et de Maine
Le Clos Lavau

Ancien fief et seigneurie avec maison noble, appartenait en 1460 à dame Perrine Jarzée, veuve de J. Frenier ; son fils Pierre Frenier, licencié en décret, 1474, et chanoine de Poitiers, 1499, rend aveu en 1503 à la seigneurie de Savennières pour sa maison appelée « la Court de la Vau » et à l'hostel et métairie d'Andine qui en formait plus tard le principal domaine ; Jean Voulsy, receveur ordinaire de Saintonge, par sa femme Jeanne Berthelot, 1540. Le fief, vendu en 1552 par du Bouschet à Pierre Gaillard, enquêteur ordinaire d'Anjou, fut réuni au XVIIIe siècle à la seigneurie de la Forêtrie.
Les terres et l'habitation passèrent par ventes successives de Michel de Cherbaie à Elie Cadu, de qui l'acquit Laurent Landévy, bourgeois d'Angers (29 novembre 1554). Jeanne Landévy y meurt en 1752, âgée de 87 ans, et ses héritiers vendirent le domaine à Mathias Genet, marchand cirier (2 mai 1753). Aujourd’hui, la partie Ouest des bâtiments n’est plus habitée. Elle est la propriété de la commune.
Source dictionnaire Célestin PORT
Plaque Gravée
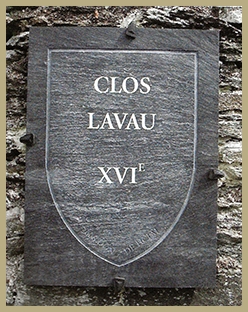 Avec, bien sûr, l'accord de leurs propriétaires, trois sites se sont vu apposer l'écusson d'ardoise, marquant ainsi leur intérêt historique et architectural. Près de l'église et du mail qui fut autrefois cimetière, ce grand bâtiment à un étage sur rez-de-chaussée et un étage droit, a subi plusieurs reconstructions et extensions, notamment au XVIIIe siècle où il a été agrandi et enjolivé par le curé, François Halnost, qui fit graver son nom et la date de 1761 sur une lucarne.
Avec, bien sûr, l'accord de leurs propriétaires, trois sites se sont vu apposer l'écusson d'ardoise, marquant ainsi leur intérêt historique et architectural. Près de l'église et du mail qui fut autrefois cimetière, ce grand bâtiment à un étage sur rez-de-chaussée et un étage droit, a subi plusieurs reconstructions et extensions, notamment au XVIIIe siècle où il a été agrandi et enjolivé par le curé, François Halnost, qui fit graver son nom et la date de 1761 sur une lucarne.
Le presbytère porte en pignon ouest la date de 1718. En 1606, Nicolas Gaudin, curé de Savennières, se déclare sujet et vassal de la seigneurie de Savennières, pour un corps de logis, pressoir, cour, jardin clos, appartenances, le tout en un tenant qui est la maison presbytérale, joignant d'un côté le chemin tendant de l'église au grand cimetière, d'autre côté la maison, cour, jardin et appartenances de la chapelle Sainte-Barbe, d'autre côté le chemin de l'église au chemin du Puy-Gauthier et d'autre bout le cimetière dudit lieu.
En 1629, Pierre Bodin rend sa déclaration à la seigneurie de Coulaine, relevant également du comté de Serrant. On peut en déduire qu'une transaction eut lieu entre les deux seigneuries. (Arch. Serrant, liasse 1074).
Pour leur maison presbytérale, les curés successifs continueront de rendre aveu à la seigneurie de Coulaine jusqu'à la Révolution. C'est en 1823 que la commune fait l'acquisition du presbytère et de ses dépendances pour en faire la « Maison commune », le logement du curé et celui de l'instituteur. En 1986, ont été inscrits à l'Inventaire des monuments historiques : les façades et toitures ainsi que le salon, au rez-de-chaussée, avec sa cheminée et son remarquable décor de toiles peintes. Ces peintures sur tentures représentent des scènes bucoliques agrémentées de nombreux oiseaux de paradis.
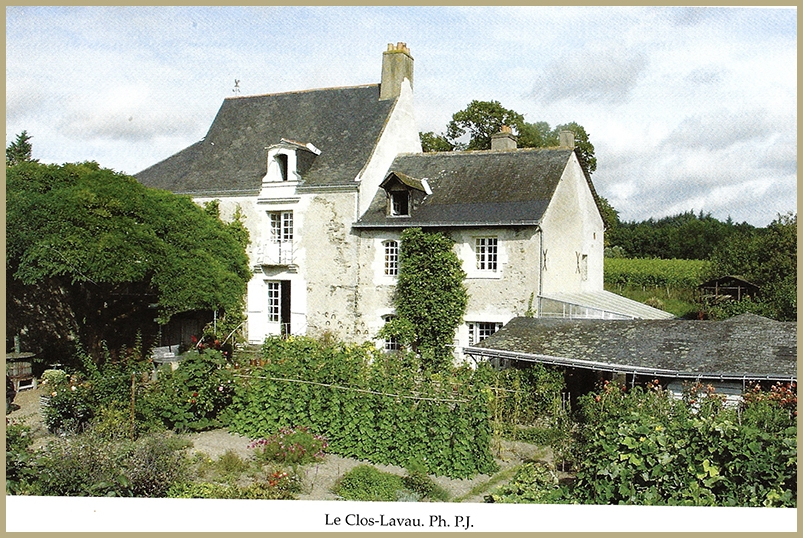
Restauration d'un vieux four à pain au Clos Lavau

Une réflexion est maintenant en cours avec l'appui des Architectes des Bâtiments de France pour l'élaboration d'un dossier de restauration. L'objectif recherché est de concilier à la fois la préservation et la mise en valeur des parties anciennes les plus remarquables avec l'installation de nouveaux services communaux tels qu'une cantine scolaire ou une salle de réunions pour les associations. Les aides financières indispensables à la réalisation de cet important projet sont à l'étude.
En attendant, le vieux four à pain qui se trouve à l'extrémité nord du bâtiment, a été remis en état de fonctionnement grâce au savoir-faire de l'association « Les Marylines ». La sole a été remplacée et le premier allumage du four a eu lieu peu après. Les habitants de Savennières, et en particulier les jeunes qui avaient « mis la main à la pâte », ont pu apprécier les belles miches sorties toutes chaudes du four. L'expérience sera répétée dans le cadre des activités de l'Espace jeunesse.
Source : Michel Marcot

Foresterie (Forêtrie)

Important fief relevant de Serrant, avec château, chapelle fondée en 1523 sous le vocable de Saint-Jean-Baptiste et dont le temporel en 1783 était estimé à 50 livres. En relevaient le fief de Lavau, les métairies de la Gicherie, les Moulins et Maison Neuve. Il appartenait en 1563 à la veuve de Jean Cadu ; en 1592, à Madelon de la Jaille qui le vend à François Bitault ; en 1637 à Pierre Bodin, secrétaire du roi, qui y réside avec sa femme Renée Doiseau, et y meurt le 4 octobre 1662.
Il avait fondé une messe dominicale. Sa soeur et unique héritière Bernardine Bodin était veuve d'Antoine Poulain dès 1664. Il passa par mariage aux Coquereau du Boisbernier. Le château est acquis en 1820 par la famille Gouin d'Ambrière, aujourd'hui à M. de Rochecouste. La chapelle est remarquable : il existe un beau retable avec une Mise au tombeau et des statues, dont la Vierge, saint Luc, saint Mathieu, etc... Voûte en bois à tirants, petit clocher avec cloche du XVe siècle.
Le Manoir a été restauré et transformé par Dainville. La tourelle carrée d'escalier se termine par un toit pointu couronné par un fleuron représentant des cigognes tenant en leur bec des vipères.
Source :Archives de Serrant. : Célestin PORT
Cet important manoir
En arrière-plan de Savennières, il a été restauré et transformé assez profondément à la fin du siècle dernier par Dainville, ancien élève des Arts-et-Métiers, architecte de la ville d'Angers et du département, directeur de l'école régionale des Beaux-Arts.
Y vécut de 1637 à 1667, y mourut Pierre Bodin, secrétaire du Roi Louis XIVe.
M. Coquereau du Boisbernier
François-Charles Coquereau du Boisbernier, écuyer, seigneur de Seillons et de la Forestrie, naquit à Angers, paroisse Sainte-Croix, le 2 octobre 1729. Il était fils de François-Charles Coquereau, écuyer, sieur du Boisbernier, avocat du roi en la sénéchaussée et siège présidial d'Angers, et de Marie-Renée Poulain de Cintré. Le 20 août 1759, il épousa, dans la chapelle du château du Boisbernier, paroisse de Noëllet, sa cousine germaine, Marie-Anne-Françoise-Perrine Coquereau du Boisbernier, fille de Jean Coquereau, chevalier, seigneur du Boisbernier, de l'Asnerie et d'autres lieux, et d'Anne Ménage.
Après avoir été officier du régiment de Vermandois d'infanterie, il demeurait à Angers, rue Boisnet, quand éclata la Révolution. Emprisonné comme suspect au château d'Angers, le 17 mars 1793, il fut transféré le 22 mars au Petit Séminaire et mis en liberté le 20 mai. Pendant le séjour que fit à Angers l'armée catholique et royale de la Vendée (17-25 juin 1793), il se trouvait en cette ville. Retiré le 2 juillet à Savennières, dans son château de la Forestrie, nous le voyons recevoir à sa table, le 8 juillet, MM. Royné, curé de Congrier, et Peltier, curé de Sceaux-d'Anjou, que les Vendéens avaient fait sortir de prison le 17 juin.
Le 9 juillet, des militaires du 6e bataillon du Nord requis par le général Fabrefonds, vont perquisitionner rue Boisnet. Ils y trouvent Mme Coquereau du Boisbernier, qui vient de recevoir de son mari une lettre l'invitant à venir à Savennières : Ne laisse rien à Angers et t'en viens ici. Amène avec toi Mme La Prieure de Sainte-Catherine. Nous nous cacherons dans les bois." Ils découvrent également une lettre de 1791 écrite par l'abbé Chauvelier, vicaire à Noëllet, qui remercie de la chambre offerte au château du Boisbernier, une autre envoyée d'Espagne le 10 décembre 1792 par le curé de la Jaille-Yvon, et enfin une dernière lettre datée du 27 juin 1793 et écrite par Bazin, procureur de la commune de Noëllet : «J'ai reçu le papier que vous m'avez envoyé ; je l'ai lu plusieurs fois ; je trouve que cela fera plutôt notre bonheur que toutes les choses qu'on nous demandait.» Vous savez que je ne me suis mis dans la municipalité que pour vos intérêts.
Le même jour, la cuisinière comparaît devant le Comité révolutionnaire d'Angers : Quelle cause à fait renfermer (en mars 1793) Coquereau dit Boisbernier ? On l'accusait alors d'avoir reçu des prêtres non assermentés. Quand est-il sorti de prison ? Il y a environ deux mois. Où était-il pendant le séjour des rebelles ? Il était resté chez lui. Quelles personnes recevait-il ordinairement chez lui ? Il voyait des nobles et des prêtres non assermentés. Quel prêtre a-t-il recelé chez lui ? Le nommé Oger, curé de la Jaille-Yvon. Où est ce prêtre ? En Espagne, où il a passé depuis longtemps. Quand Coquereau est-il sorti d'Angers et pour quelle raison ? Il est parti il y a aujourd'hui huit jours pour sa maison de Savennières.
Aussitôt, on mande François-Charles Coquereau du Boisbernier, qui, le 10 juillet, est interrogé par le Comité révolutionnaire : Interrogé de dire pourquoi il a écrit à sa femme de venir se cacher avec lui dans les bois. À répondu que c'était pour éviter d'être arrêté, attendu qu'il l'avait été une première fois. À lui demandé pourquoi on trouve dans ses poches un imprimé portant pour titre : Hymne en l'honneur des glorieux défenseurs de la patrie, qualifiés de brigands. À répondu que comme ces imprimés se vendaient publiquement, il en a acheté un.
À lui demandé pourquoi il a correspondance avec le nommé Bazin, procureur de la commune de Noëllet, qui paraît être mauvais citoyen, et quel est l'écrit dont Bazin lui accuse réception et qu'il croit devoir faire notre bonheur plutôt que toute autre chose. À répondu que Bazin était chargé de ses affaires à Noëllet et que l'écrit qu'il lui avait envoyé était une proclamation faite par les brigands.
À lui demandé pourquoi il envoie de semblables écrits à un procureur de la commune. À répondu que c'était pour qu'il en prit lecture.
À lui demandé pourquoi il colporte des écrits contre toutes les lois. A répondu que cet écrit était public.
À lui demandé s'il reconnaît comme loi ce qui est fait par les brigands. A répondu que oui et que dans le moment il était obligé de leur obéir.
À lui demandé pourquoi il entretient correspondance avec le nommé Chauvelier, vicaire non assermenté et fanatique d'après la lettre qui est en nos mains, comme aussi pourquoi il lui avait offert sa chambre.
À répondu qu'il ne lui avait pas demandé la lettre qu'il avait écrite, et qu'à cette époque il était permis de les loger (les prêtres insermentés).
À lui demandé qui l'avait forcé à prendre la cocarde blanche.
À répondu personne, et qu'il l'avait portée pendant deux jours à l'exemple de plusieurs autres et a signé Du Boisbernier.
À lui demandé pourquoi il fait précéder son nom du mot "du" et pourquoi il signe un nom qui est un nom de terre et prohibé par les lois.
À répondu parce qu'il a toujours signé de même et que la noblesse n'était pas une chose défendue, et a signé Coquereau Boisbernier. A l'issue de l'interrogatoire, l'inculpé est emprisonné et sa femme mise en état d'arrestation dans son domicile
Dès le 13 juillet, il subit un second interrogatoire de la part de la Commission Militaire : Interrogé sur ses prénoms, nom, profession, âge et demeure. À répondu qu'il s'appelle François-Charles Coquereau Boisbernier, âgé de 64 ans, sans profession, gentilhomme, demeurant ville d'Angers, rue Boisnet. A lui demandé pourquoi il s'est caché dans les bois. Ä répondu qu'il ne s'est point caché et qu'il était chez lui. À lui fait observé qu'il est en contradiction avec ce qu'il a dit dans son précédent interrogatoire, puisqu'il a déclaré s'être caché dans les bois et qu'aujourd'hui, il nous dit le contraire. À répondu qu'il ne s'est point caché.
À lui observé qu'il ne nous dit point la vérité, puisque dans une de ses lettres à son épouse, il lui marquait de venir se cacher dans les bois. A répondu qu'il n'était pas caché, et que ce n'était que pour éviter la persécution et la tyrannie qu'il engageait son épouse à se cacher avec lui dans les bois. Interrogé pourquoi on a trouvé dans ses poches un imprimé ayant pour titre : Hymne en l'honneur des vrais défenseurs de la patrie, qualifiés de brigands.
À répondu qu'il l'avait acheté et qu'on le vendait publiquement dans les rues.
À lui demandé s'il n'a pas envoyé la proclamation faite par les brigands à quelques personnes de sa connaissance.
À répondu l'avoir envoyée à son homme d'affaires, parce qu'alors elle était permise.
À lui demandé pourquoi il dit qu'elle était permise dans ce temps-là.
À répondu que c'est parce qu'on la vendait publiquement et qu'il faut obéir au plus fort.
À lui demandé s'il n'a pas eu des correspondances avec les émigrés et les prêtres non assermentés.
À répondu que non, mais qu'il a secouru les prêtres non assermentés parce qu'ils étaient dans le besoin et qu'il ne refuse la charité à personne.
À lui demandé dans quelle intention il avait une correspondance avec un nommé Oger, prêtre réfugié en Espagne.
À répondu qu'il n'avait point eu de correspondance avec les prêtres exportés, qu'au surplus la lettre d'Oger, n'avait rien contre la nation.
À lui demandé s'il a prêté le serment civique demandé par les représentants du peuple français. A répondu que non, et qu'on ne le lui a pas demandé, n'ayant jamais rien dit contre la nation. A lui demandé s'il a pris la cocarde blanche. A répondu que oui et qu'il l'a portée pendant deux jours, ne se faisant pas plus prier pour la cocarde blanche que pour celle tricolore.
À lui demandé à quelle époque il a pris la cocarde blanche.
À répondu que c'est à l'entrée de l'armée catholique dans la ville d'Angers.
À lui demandé s'il a été forcé de la prendre. A répondu qu'il l'a prise comme les autres. Interpellé de nous déclarer par oui ou non sur le fait dont il est interrogé. A répondu qu'il n'a pas été forcé de prendre la cocarde blanche. A lui demandé de qui il redoutait les persécutions et les tyrannies. A répondu vaguement, en disant qu'il avait été mis en arrestation sans savoir pourquoi.
À lui demandé s'il reconnaît pour loi ce qui a été fait par les brigands. A répondu que non, mais que dans ce temps il l'a reconnu. A lui demandé pourquoi il se qualifie d'un surnom et signe Coquereau du Boisbernier, puisque la Convention l'a défendu par une loi. A répondu que c'est par habitude. A lui demandé si pendant le séjour des brigands en cette ville il n'a pas eu des liaisons avec eux. À répondu que non.
À lui demandé quelles étaient ses relations avec un officier municipal de Noëllet et quel est son nom. A répondu qu'il s'appelle Bazin et qu'il n'a de liaisons avec lui que pour ses affaires, étant son homme d'affaires.
À lui observé qu'il ne nous dit pas la vérité, puisque, par une lettre que lui écrit Bazin, ce dernier lui marque qu'il n'a accepté la place d'officier municipal que pour l'instruire de tout ce qui se passerait. A répondu que Bazin ne l'avait jamais instruit de ce qui se passait, excepté de ses affaires en lui répondant.
À lui observé qu'il est en contradiction avec lui-même, puisqu'il vient de nous dire qu'il n'avait d'autre correspondance avec Bazin que pour ses affaires particulières, tandis qu'il lui a envoyé la proclamation des brigands qui n'a aucune relation à des affaires particulières. A répondu que c'était pour l'instruire de ce qui se passait alors, sans affectation ni dessein.
Le même jour, 13 juillet, le prisonnier est renvoyé par la Commission Militaire devant le Tribunal Révolutionnaire de Paris, et aussitôt les représentants du peuple Louis Turreau, Bourbotte et Tallien arrêtent qu'il sera traduit à Paris.
Source : !La Maraîchine Normande

Transféré à la Conciergerie, il est interrogé très sommairement le 19 juillet par le président du Tribunal Révolutionnaire, et le 22 juillet, Fouquier-Tinville dresse l'acte d'accusation que nous allons reproduire : Boibernier, se disant ci-devant gentilhomme et demeurant à Angers, a été dans tous les temps ennemi juré de la Révolution. Sa maison était un réceptacle de contre-révolutionnaires, de prêtres et defemmes fanatiques.
Il distribuait et colportait les écrits et proclamations des brigands révoltés contre la République, tendant à pervertir l'esprit public et à grossir le parti des révoltés. Lors de leur entrée à Angers, il a sur-le-champ et de son propre mouvement arboré la cocarde blanche et exécuté tout ce qui était prescrit par eux, qu'il regardait comme loi. Pendant leur séjour à Angers, il y est constamment resté et ne recevait chez lui que des ci-devant nobles et des prêtres réfractaires. Lorsqu'ils ont évacué cette ville, Coquereau s'est retiré et caché à la campagne, et a écrit à sa femme d'enlever ce qu'il avait de précieux chez lui, de venir se cacher avec lui et d'emmener avec elle une ci-devant religieuse.
Il entretenait aussi des correspondances avec des prêtres déportés. Lors de son arrestation, il a été trouvé dans ses poches un imprimé ayant pour titre Hymne en l'honneur des glorieux défenseurs de la patrie, qualifiés de brigands par les oppresseurs de la France, chanté lors de leur entrée triomphante à Angers le 17 juin 1793, par un bon Français, prêtre persécuté pour sa foi et sa fidélité à son prince légitime, lequel écrit outrageant à la République, provoquant sa dissolution, le rétablissement de la royauté en France et les citoyens à s'armer les uns contre les autres pour allumer la guerre civile." Le jugement qui le condamne à mort le 25 juillet ajoute : Un exemplaire d'un écrit imprimé en huit pages , ayant pour titre Hymne en l'honneur des glorieux défenseurs de la patrie qualifiés de brigands, commençant par ces mots : L'hymne qu'on va lire et finissant par ceux-ci : L'an premier du règne de Louis XVII, signé La Rochejaquelein, trouvé dans la poche de Coquereau, sera par l'exécuteur des jugements criminels lacéré et brûlé au pied de l'échafaud, sur la place de la Révolution.
C'est dans la soirée du même jour 25 juillet 1793 que François-Charles Coquereau du Boisbernier, ci-devant gentilhomme et ancien officier du régiment de Vermandois d'infanterie, fut guillotiné sur l'ancienne place Louis XV, appelée alors place de la Révolution et aujourd'hui place de la Concorde. Le Roi Louis XVI avait été exécuté sur la même place le 21 janvier précédent.
[Son défenseur se nommait Julienne]
Source : !La Maraîchine Normande

FRESNE
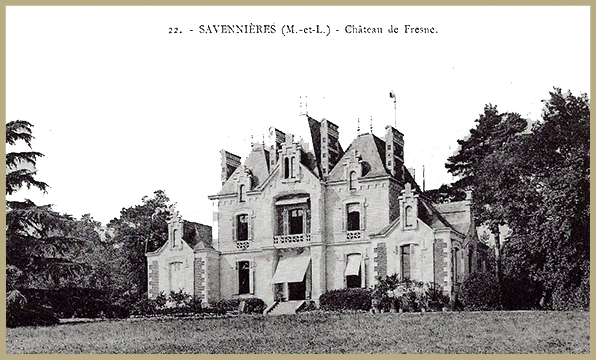
À la sortie Ouest du bourg de Savennières, le Fresne, ancienne propriété des Cesbron. Ce petit château, d'une douzaine de pièces entouré d'un parc de trois hectares, date de la seconde moitié du XIXe et jouit d'une jolie vue sur la Loire et le moulin de la Petite Roche.
Parc du Fresne

Voici la plus vaste tonnelle de l’Anjou. 20 à 25 mètres de haut, un feuillage qui couvre une surface de 40 mètres de diamètre soit environ 1300 m Il faut dire qu’il triche, ce platane, car il possède trois troncs dont chacun peut faire figure d’arbre remarquable. Alors que dire de l’ensemble ?

Il s’agirait en fait de deux sujets distincts. Le plus imposant possède un tronc double qui mesure une quinzaine de mètres au sol et se dédouble à environ 1m30. À cette hauteur, l’ensemble présente 12 m 60 de circonférence et on trouve 6 m 60 et 7 m 90 pour les deux troncs. Le plus gros possède une charpentière quasi horizontale qui, de par son volume, pourrait aisément faire office de quatrième tronc.
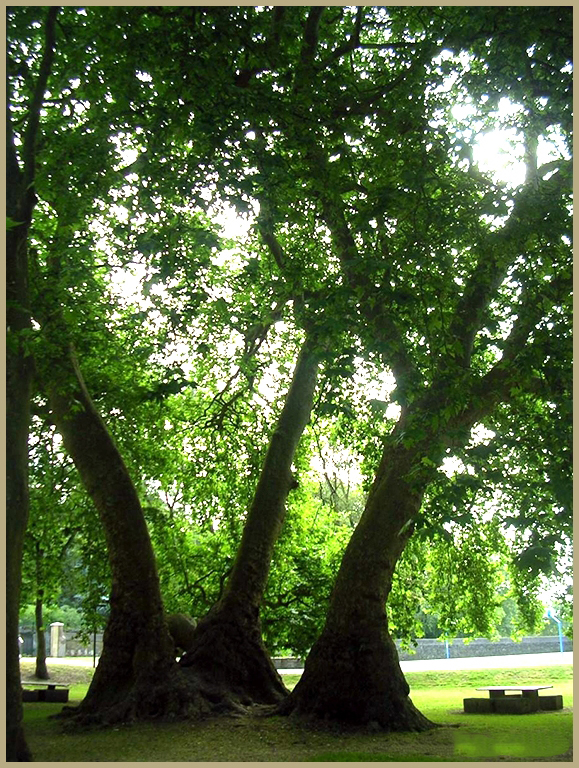
Le deuxième arbre mesure 6 m 70 à 1 m 30 ce qui est déjà en soi impressionnant. Le parc du Fresne occupe un emplacement qui appartenait au fief de la Guerche, manoir seigneurial connu depuis le XIIe siècle. Mais en l’absence de document suffisamment explicite, l’âge des platanes n’a pu être précisément déterminé.
Toutefois, si l’on compare les dimensions indiquées ci-dessus à celles des plus gros arbres de France, on peut faire un rapprochement avec le platane de Santenay (Yonne) planté sous Henri IV (1599). Pour le moins, ces arbres peuvent avoir été plantés au XVIIIe siècle, période de son introduction dans les parcs.
Il doit avoir environ 250 ans. D’autant que les bases des troncs me semblent un peu boursouflées par rapport au diamètre des fûts à mi-hauteur. Sans doute une réaction pour résister aux flexions énormes imposées par les houppiers.
Source : https://krapooarboricole.wordpress.com
Comme bien souvent, on est saisi par la taille des branches et des troncs que seuls les platanes sont capables d’ériger ainsi. Je suis allé voir ce géant à deux occasions. Une fois en plein après-midi estival où j’ai pu juger de l’efficacité du feuillage qui prodiguait une douce fraîcheur salvatrice. L’autre fois, de bon matin, il y régnait une ambiance calme particulièrement délectable.
Détails des Platanes par Ph. d'Ersu et J. Marcot.
A l'heure où se prépare l'inventaire des arbres remarquables du Maine-et-Loire par le Conseil Général et le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement (C.A.U.E.) pour les lieux publics et par la Société d'Horticulture d'Angers pour les arbres du domaine privé, Savennières peut s'enorgueillir de posséder dans son parc public du Fresne un platane géant.
Il a poussé dans une prairie marécageuse et inondable près de la boire dite du Canal, ancien port fluvial de la commune au fond d'un petit vallon drainant le secteur des Cendres où les sources sont nombreuses, entre les châteaux de la Guerche à l'est et du Fresne à l'ouest.
Son port est majestueux avec une hauteur de l'ordre de 25 mètres. Sa ramure couvre une surface circulaire de près de 1300 m2 avec un rayon moyen de 20,20 m et un périmètre de ramure de 130 m à 2 m de hauteur.
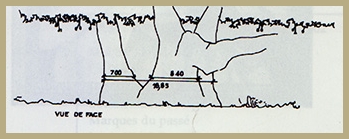
Ce platane a fait l'objet d'un article du chanoine Robert Corillion publié en 1993 par la Société d'Etudes Scientifiques de l'Anjou. Notre géant se présente comme un arbre multi-troncs, ce qui complique sa description et la prise de ses mensurations.
Les spécialistes s'accordent pour dire qu'il s'agit en fait de deux arbres : un sujet principal se divisant rapidement en deux puis trois gros troncs, et, d'autre part, un individu voisin planté trop près dans sa jeunesse. Cela constitue un ensemble extraordinaire, car les souches sont soudées en un tout.
Nous avons mesuré nous-mêmes les cotes suivantes à 1 m de hauteur au-dessus du sol.
Circonférence de l'ensemble des troncs : 18 m.85, circonférences de chacun des différents troncs : 8.40 m, 7.00 m et 6.60 m
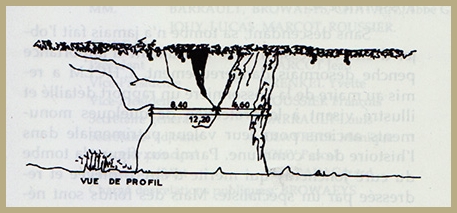
Si l'on veut comparer notre géant aux plus gros arbres de Maine-et-Loire ou de France, il faut considérer le sujet principal dont la circonférence est déjà honorable : 12,30m à 1 m du sol. À partir de cette mensuration, notre géant est à notre connaissance à l'échelon départemental :
- Le plus gros platane du M. et L.
- Le 3e plus gros arbre du M. et L.
- À l'échelon national : le 2e plus gros platane de France
Pour les connaisseurs, le genre Platanes comprend trois espèces : Platanes accidentais à feuilles très peu lobées (très peu découpées), espèce à peu près disparue ; Platanes orientalis à feuilles très profondément découpées ; le lobe central de la feuille est plus long que large.
C'est l'espèce noble que l'on trouve dans les parcs. L'écorce du tronc s'exfolie peu et le tronc a souvent des boursouflures. Platanes X hispanica (ex P. X acerifolia), l'hybride des deux précédents. C'est le plus commun, notamment au bord des routes et des avenues.
L'écorce s'exfolie abondamment. Comme le précédent, il a été introduit en France vers 1550. Notre géant de Savennières est un Platanus orientalis, le Platane d'Orient. C'est une essence qui a été largement répandue à la fin du XVIIIe, le premier platane parisien ayant été planté par Buffon en 1750.
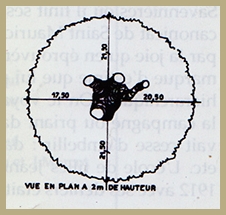 Celui du Parc Moneau ne mesure que 7.05 m de circonférence. Le Petit Larousse attribue à l'espèce une longévité maximum de 500 à 2000 ans et une hauteur pouvant atteindre 40 m. Mais le Quid ne mentionne dans les records qu'un sujet à Marseille de 500 ans et un autre à Saint-Guilhèm-le-Désert de 300 ans. Le Grand Larousse illustré le dit originaire d'Asie Mineure.
Celui du Parc Moneau ne mesure que 7.05 m de circonférence. Le Petit Larousse attribue à l'espèce une longévité maximum de 500 à 2000 ans et une hauteur pouvant atteindre 40 m. Mais le Quid ne mentionne dans les records qu'un sujet à Marseille de 500 ans et un autre à Saint-Guilhèm-le-Désert de 300 ans. Le Grand Larousse illustré le dit originaire d'Asie Mineure.
Il aurait pénétré en Gaule après la prise de Rome par les Gaulois en 385 av. JC. puis sa culture aurait été peu à peu abandonnée. Ce n'est qu'à partir du XVIIe siècle qu'on commença à le rechercher comme arbre d'ornement dans les jardins et le long des avenues, car sa cime large et régulière procure un ombrage dense.
Son tronc nu sur une grande partie est recouvert d'une écorce verdâtre qui se détache par plaques, surtout chez l'hybride. Les feuilles sont alternes, palmées et plus ou moins lobées. Leur pétiole dilatée et creusée à la base recouvre le bourgeon. Les fleurs monoïques sont groupées en chatons globuleux et les fruits sphériques et velus pendent longtemps en hiver après la chute des feuilles. Quant à l'âge exact de ce géant, nous nous en remettons au Chanoine Corillion qui lui attribue au moins 200 à 250 ans et peut-être même 400. Toujours est-il qu'il semble en parfaite santé et bien en situation de pouvoir tenir encore plusieurs siècles.

Grifferaie-(Grifferays) (Les)
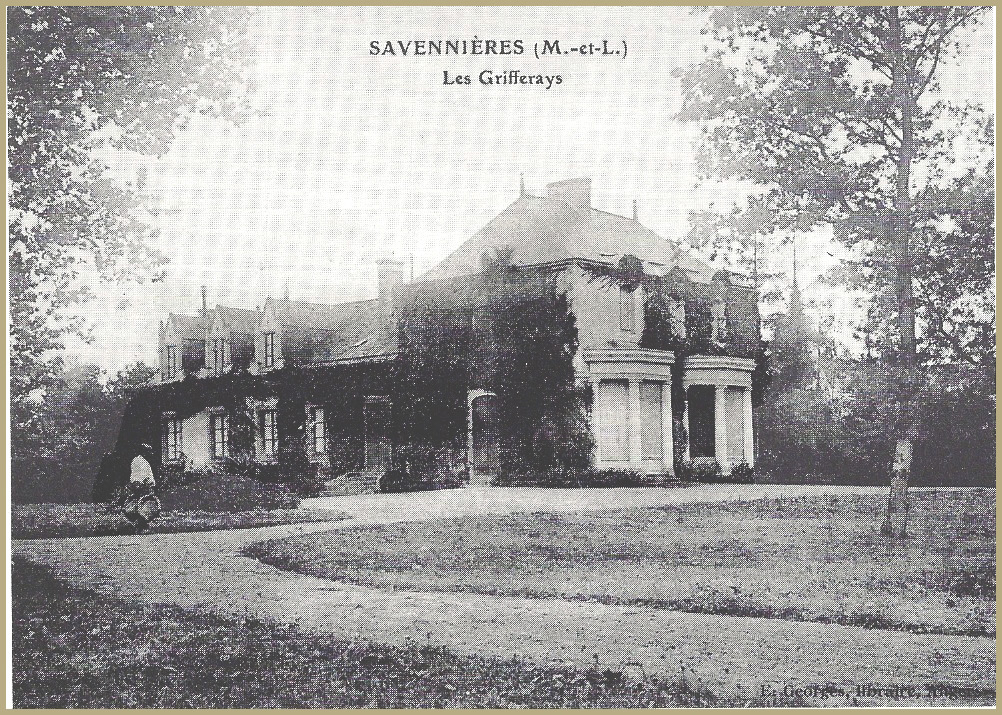
On ne possède aucun document fiable permettant de déterminer l'étymologie du nom du lieu. Peut-être est-il issu du latin acrifolium ( houx). On aurait alors affaire à un bois de houx défriché pour laisser la place à des champs et à un village de cultivateurs.
Ce château, tout à l'arrière-plan de Savennières, a deux grands corps de bâtiments entourés de douves ; il fut reconstruit au milieu du siècle dernier. L'ancien fief relevait des Molières, château voisin sur la communauté de Beaucouzé, mais près d'Angers.
Il appartint aux familles Verdier et Bréchu, de Cheverue et de Morant. Dans un angle de l'édifice, une chapelle dédiée à la Vierge fut consacrée en 1736 par le curé de Savennières.
La Guerche
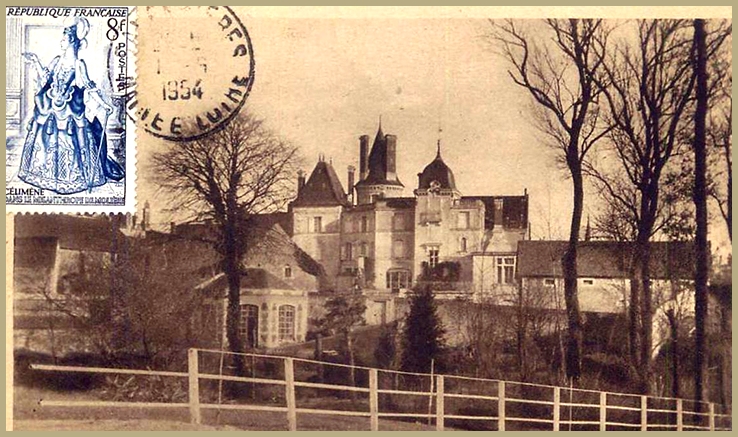
Ce toponyme qui marquait l’emplacement d’une probable défense bretonne contre les invasions normandes est situé en bordure d’une ruelle appelée rue de La Motte. Il est possible que cet emplacement ait perduré sous la forme d’une motte, bien que les familles de milites soient absentes de Savennières au XIIe siècle.
Possible réutilisation en motte. La présence d’un toponyme La Guerche à Savennières est pleine d’intérêt. Le toponyme de La Guerche désignait les fortifications proches des voies d’eau érigées par les Francs pour défendre leurs positions, notamment contre les Normands. Ce toponyme est le seul qui subsiste sur la rive nord de la Loire en Anjou. Il n’en existe pas sur la Maine, ni sur la Mayenne, ni sur la Sarthe, ni sur le Loir en Anjou.
Le toponyme occupe un site à l’ouest de Savennières, séparé de l’église paroissiale de quelques centaines de mètres et en bordure d’un bras de la Loire en cours de comblement et qui était encore actif à la moitié du XIXe siècle. La Guerche occupe vers 25 mètres d’altitude le rebord du plateau qui domine la Loire vers le nord d’environ 10 mètres, soit en dehors des zones inondables. Un château du XIXe siècle occupe actuellement le site qui est connu depuis le XVe siècle comme seigneurie.
Bien que fortement bouleversé par l’urbanisation et par la construction actuelle, l’étude du cadastre ancien indique la possibilité de l’existence passée d’une motte à La Guerche surveillant le passage par voie d’eau. Cette implantation confirme l’importance de la voie fluviale.
Pour G. Souillet, ces toponymes sont généralement situés à proximité des voies romaines et sont rarement des sites défensifs malgré l’étymologie. Or, ici, comme à Saint-Aubin-de-Luigné, et accessoirement à Chaudefonds-sur-Layon , le site est défensif, certes modérément, et la proximité d’une voie romaine improbable. La Guerche à Savennières, qui a peut-être été transformée en motte vers le XIe-XIIe siècle, se trouve entre église et Loire, dans une zone probablement rapidement habitée.
Source : Doyenné de Candé par Michel PECHA
Plaque Gravée
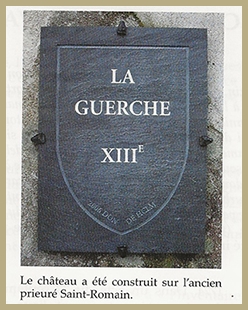 Cet imposant château, à l'entrée ouest du bourg de Savennières, a été malheureusement défiguré sur l'arrière quand il fut aménagé et transformé en maison familiale après la mort de son propriétaire d'alors, le commandant Cottereau.
Cet imposant château, à l'entrée ouest du bourg de Savennières, a été malheureusement défiguré sur l'arrière quand il fut aménagé et transformé en maison familiale après la mort de son propriétaire d'alors, le commandant Cottereau.
Il a toutefois conservé une belle façade sur le parc à l'est et l'ensemble, composé aujourd'hui de volumes variés encadrés par de beaux arbres, offre des contrastes qui lui confèrent un charme particulier.
Côté parc, les différents volumes s'articulent autour d'une haute tourelle d'escalier coiffée d'un toit conique et pointu, tandis que côté ouest, sur rue, la façade est dominée par une autre tour coiffée à l'impériale.
L'ensemble est à étage droit sur rez-de-chaussée de plain pied avec combles habitables éclairés par des lucarnes à linteaux surbaissés. Les maçonneries sont traditionnellement enduites au mortier de chaux et sable de Loire qui leur donne un aspect rosé contrastant avec les chaînes d'angle et les encadrements de baies harpés en tuffeau.
Le château a été construit sur l'ancien prieuré Saint-Romain dépendant de l'abbaye de Saint-Serge. Avant la Révolution, la seigneurie de la Guerche, avec fief et manoir, dépendait de celle de Savennières relevant du comté de Serrant.
Le manoir fut transformé et agrandi au cours des siècles. Au XXe siècle, après la mort des Cottereau, le château a été transformé en 1964 en maison familiale pour l'organisation de stages puis de colonies de vacances de 1972 à 1981, avant d'être racheté par un particulier.
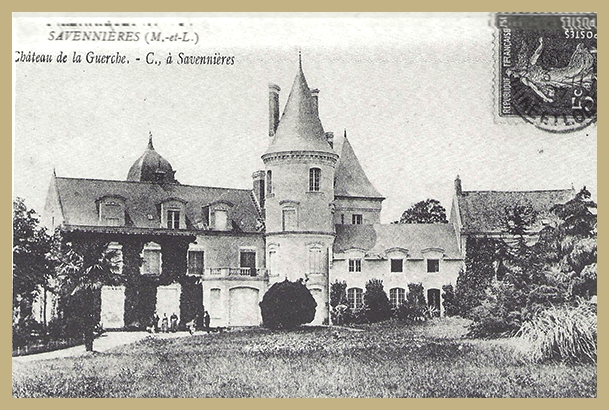
Sources : Notes de Jean Marcot- Archives de Serrant-.Louis Barrault.
1482 - est sieur Pierre de la Court, écuyer, 1546-n.b Jean Lenfant, qui vend la terre à Philippe Salmon et Louise de la Court, sa fiancée.
1539 - Renée Lebreton, veuve Cadu, seigneur de la Touche-Cadu et des Brosses
1595 - Biltault François, sieur de la Raimberdiére, fils d'André, né à Angers en 1534, s'était fait un renom comme avocat en la sénéchaussée d'Angers quand il fut élu échevin de la ville le 15 décembre 1564 et maire le 1 mai 1582, honneur qu'il briguait depuis longtemps et où il fut continué en 1583. Il représentait, comme son beau-frère Jean Ayrault à qui il succédait, la caste énergique, même agressive, de la haute bourgeoisie locale, à l'encontre des officiers du roi et du Présidial surtout, qui tentait d'envahir partout les privilèges et la prééminence. Il eut aussi sous son second mairat à pourvoir aux misères publiques soulevées par une peste terrible qui en août, septembre et octobre 1583 dépeupla la ville, où toute affaire cessa. Le concile de Tours qui s'y était transporté le 8 septembre dut hâter la clôture de ses réunions. Mort en mai 1802. Portait d'azur au chevron de sable, accompagné de trois croix pattées d'argent, deux en chef et une en pointe.
1715-Antoine Poulain, sieur de la Tirlière.
1789-Guill. Poulain, grand-chantre et chanoine de l'église d'Angers, seigneur de la Guerche et de Lavau, paroisse de Savennières.
Découvertes
Dans les massifs du jardin, on a. trouvé des cercueils en pierre de 60 à 80 centimètres de profondeur, en forme d'auge, avec couvercle plat ou en dos-d'âne ; à la porte, un chapiteau à crochets et des débris de colonnes et de chapiteaux XVe siècle ; dans le mur, une arcade avec autel et statue de Saint Romain, de style XIIe siècle, qu'on prétend provenir d'une église de ce nom, autrefois, dit-on, sur l'emplacement de la maison.
Source : Célestin PORT

Varennes

Retracer l'histoire d’une maison, qu'elle soit pavillon, chaumière, maison bourgeoise ou château, est toujours un travail passionnant. On ne peut en effet se contenter de parler des pierres, on est vite amené à évoquer ceux qui l'ont habitée et ont contribué à la rendre ce qu'elle est devenue à travers les âges.
Les lignes suivantes essaient de relater, autant que les sources le permettent, les faits et gestes des familles qui ont habité et embelli VARENNES à Savonnières au tour des cinq derniers siècles. L'origine du nom « Varennes » prête à discussion.
Sans entrer dans les détails qui permettent d'avancer que "garenne" et "varenne" sont des variantes dialectales, retenons qu'il s'agit d'endroit où l’on garde le gibier, et le poisson, et où il est interdit de chasser ou de pécher. Fréquemment rencontré sur nos bords de Loire, il désigne souvent des terrains inondables, notamment en Touraine.
On sait peu de choses sur les neuf premiers siècles mais on peut imaginer que cet endroit, très probablement couvert de taillis, comme il en existe encore dans la région, devait servir de lieu de chasse aux hommes d'arme et aux marchands qui circulaient sur la Loire et trouvaient dans les petites coulées une anse favorable au repos et au ravitaillement - il existe toujours deux sources a l'eau très claire - d'autant plus qu'en remontant le courant vers le nord il faut ramer jusqu'a Bouchemaine pour trouver une situation semblable, les coteaux de la Roche aux Moines et d'Epiré tombant à pic dans la Loire.
En 1028, un texte mentionne "les forges" comme lieu habité à trois cents mètres de Varennes et le village de Savennières est cité au VIIe siècle.
XVe et XVIe siècles : Les TILLON
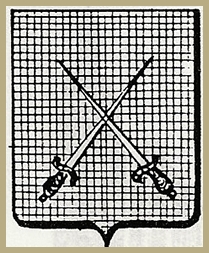 En 1457, un acte conservé aux Archives du Maine-et-Loire cite "la terre et seigneurie de Varennes" relevant pour le principal domaine de la Guerche en Savennières. En est seigneur Pierre TILLON, puis Guillaume TILLON (1534) marié à Renée d'OYRON, dame de Chavagne Pelaud.
En 1457, un acte conservé aux Archives du Maine-et-Loire cite "la terre et seigneurie de Varennes" relevant pour le principal domaine de la Guerche en Savennières. En est seigneur Pierre TILLON, puis Guillaume TILLON (1534) marié à Renée d'OYRON, dame de Chavagne Pelaud.
La famine TILLON qui porte l’écu "de sable à deux épées croisées d’argent" garde les deux rives de la Loire car elle possède aussi sur la rive gauche, devant Varennes, le fief de Mantelon-sur-Denée), il reste de cette époque un pavillon carré portant les armoiries des TILLON.
Charles TILLON qui succède à Guillaume épouse le 8 février 1526 Béatrix de Sainte-Maure. Leur fils René, seigneur de Varennes de la Touche Moreau, participa, au début de la longue guerre civile qui se déroula en France de 1560 à 1598, à la "Journée des mouchoirs" Angers. L'échec de la conjuration d’Amboise avait eu beaucoup de retentissement en Anjou. Lors de la convocation des Etats Généraux pour la désignation des délègues des trois ordres, les esprits étaient très échauffés.
Le 14 octobre 1566, la réunion des délègués de la noblesse d’Angers se fit dans un grand tumulte. Apres le discours de l'avocat du Roi, GRIMAUDET, et de l'orateur des catholiques, une bagarre éclata et l'assistance sortit les épées et les dagues. Pour éviter les méprises "les huguenots, tous en même temps, mirent tous leurs mouchoirs tout au bout de leurs chapeaux et autour de leurs cols pour, s'entre recongnoistre, dont on les appela des morveulx et non plus des huguenots". Il y eut de nombreux blessés mais pas de tués ce jour-là.
René TILLON marié en 1561 à Françoise de DUREIL, eut une fille Marguerite qui épousa avant 1586, Louis de la CHAPELLE, seigneur de la Roche-Giffard, puis avant 1620, Vincent DESHOMMEAUX.
.
XVIIe siècle : CONSTANTIN
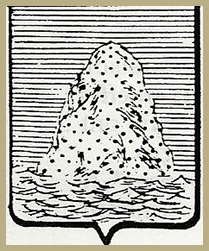 En 1634, le domaine de Varennes est acquis par Jacques Pierre CONSTANTIN, écuyer, seigneur de Varennes et de Montriou, (près de Feneu M. et L.) ; sa famille est originaire de Saint-Malo. Conseiller du roi, maitre ordinaire puis doyen de la Chambre des Comptes de Bretagne, il épouse le 31 janvier 1622 à Saint-Maurille d'Angers Anne MARTINEAU, fille de Charles, dont il eut trois enfants : Jacques (1624,) Robert (1627) et Gabriel. Le nom de Jacques Pierre parait sur les registres paroissiaux en 1636. Il évita la peste qui en 1638 frappe à Varennes J. BOUSSAIS ainsi que les deux enfants de Pierre ROCHER, le meunier du "Moulin-au-Gay » .
En 1634, le domaine de Varennes est acquis par Jacques Pierre CONSTANTIN, écuyer, seigneur de Varennes et de Montriou, (près de Feneu M. et L.) ; sa famille est originaire de Saint-Malo. Conseiller du roi, maitre ordinaire puis doyen de la Chambre des Comptes de Bretagne, il épouse le 31 janvier 1622 à Saint-Maurille d'Angers Anne MARTINEAU, fille de Charles, dont il eut trois enfants : Jacques (1624,) Robert (1627) et Gabriel. Le nom de Jacques Pierre parait sur les registres paroissiaux en 1636. Il évita la peste qui en 1638 frappe à Varennes J. BOUSSAIS ainsi que les deux enfants de Pierre ROCHER, le meunier du "Moulin-au-Gay » .
En 1642, le 13 décembre l'aveu rendu par Jacques CONSTANTIN, sieur de Varennes, du Bignonée et de Landeronde, a Pierre BODIN seigneur du fief de la Guerche, énumère l’inventaire du domaine : maisons, grange, pressoir, chapelle, forge, cour, vignes, bois, étang, garenne, faisant le tiers au plus des limites de Varennes, 10 arpents, la métairie de la Jobarderie, trois quartiers de vignes au clos des Fougeraie, au lieu nommé la bataille, le clos des Moriers à la fontaine Saint Martin, le bois du Goupillou, Rochepinte.
Le 4 aout 1647, en la chapelle de Béhuard, Jacques CONSTANTIN épouse en secondes noces Jeanne MARTINEAU, veuve de Jacques LICQUET qui fut la "dame" de Varennes pendant près de quarante ans, son nom est sur la porte ! Les armoiries de la famine MARTINEAU étaient sculptées en effet au fronton d’une porte de la terrasse « d’argent à deux étoiles en chef et, en pointe, au chevron d'azur accompagné de trois oiseaux ou martinets de sable poses deux et un». Elles figurent actuellement, en 1995, au troisième étage sur le mur extérieur du grand bâtiment, côte nord, entre deux masques de femmes représentant la vieillesse à l’est et la jeunesse à l'Ouest.
Le troisième enfant de Jacques, Gabriel CONSTANTIN, suit les traces de son père : il est conseiller du roi, correcteur à la Chambre des comptes de Bretagne lorsqu'il épouse, en 1652 (le 3 décembre), Anne LEPELLETIER, fille du grand Prévost d’Anjou, seigneur de la Lorie, René LEPELLETIER. Ils eurent neuf enfants et beaucoup d’ennuis ; non seulement Anne ne reçut pas sa dot, mais elle dut aider son père à payer ses créanciers et à sortir de la Conciergerie où les dépenses faites sous l'emprise de sa maitresse l'avaient conduit.
Ses dettes s'élevaient à plus de huit millions de livres, somme énorme pour cette époque. En 1661, Gabriel CONSTANTIN rachète le château de la Lorie et, en 1662, par suite du décès de son beau-frère Armand LEPELLETIER, il devient grand prévôt d'Anjou. Mais ayant sans doute besoin de compenser les frais engagés pour désintéresser les créanciers de son beau-père, après avoir vendu Montrion, il vend Varennes au noble homme Jacques AVRIL, sieur de la Chaussée, en 1663. Jeanne MARTINEAU, cependant continue à vivre à Savennières ; on relève que le 3 février 1670, elle fonde la chapelle seigneuriale de Varennes avec obligation de résidence pour le titulaire et elle est citée comme marraine en 1679 et 1683.
Elle meurt à Varennes le 30 décembre 1684, un an après son fils Gabriel qui décède en 1683 dans sa maison d’Angers, rue de la Croix-Blanche. Comme son père, il reçut une "lettre d'honneur" du Roi de France le 25 février 1677 en considération des services rendus dans l'exercice de sa fonction de conseiller du Roi et maître des comptes de Bretagne. Les CONSTANTIN ont tenu en effet une place importante dans l'histoire de l'Anjou et ils ont privilégié leur domaine de la Lorie près de Segrè et leurs maisons d'Angers dont on a des inventaires très détaillés. Pour Varennes, on ne possède que la description dans le Pacte de vente.
Cette vente est passée le 29 janvier 1663 par-devant Me François CROSNIER et comprend non seulement "la maison, terre, fief de la seigneurie de Varennes, pressoir, jardins, verger, pré, pastière, pâturage, étang, bois de haute futaie, grand clos de vigne, le tout enclos de murailles" mais aussi les métairies de Mangeard, la Rouselle, la Roberderie, la Monnayrie, les closeries de la Doublonniere et du Bignonnet, plus des parcelles isolées. La vente est conclue pour les sommes de 49 000 livres, plus 49 000 livres pour les animaux et dépendances et 3 000 livres pour les meubles. Une somme est réservée pour la présentation de la chapelle et les droits de l'Église de Savennières.
Les armoiries des CONSTANTIN se lisent : "D'azur à un rocher d'or mouvant des ondes d’une mer d’argent mouvante". Celles de leurs successeurs sont "D'or au lion de gueules, armé et lampassé de même".
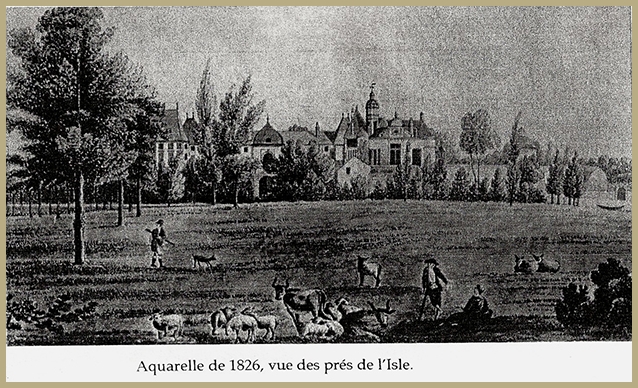

XVIIIe siècle : Les LA TULLAYE
 À quelle date les LA TULLAYE prennent-ils possession de Varennes ? La famille de Jacques AVRIL n'a pas laissé de traces à Savennières. Les LA TULLAYE connaissaient Varennes puisque l'on trouve la signature de l'un d'eux, en tant que procureur de Jeanne MARTINEAU-CONSTANTIN, dans des actes datant d'avril 1659 et mars 1664. Avec André JOUBERT, qui remarque que la présence des CONSTANTIN à Varennes n'a duré que cinquante ans, nous dirons que la famille LA TULLAYE est arrivée aux environs de 1684, date confirmée par l'acte de baptême à Savennières de Louis Salomon de LA TULLAYE, seigneur de Varennes le 27 octobre 1691.
À quelle date les LA TULLAYE prennent-ils possession de Varennes ? La famille de Jacques AVRIL n'a pas laissé de traces à Savennières. Les LA TULLAYE connaissaient Varennes puisque l'on trouve la signature de l'un d'eux, en tant que procureur de Jeanne MARTINEAU-CONSTANTIN, dans des actes datant d'avril 1659 et mars 1664. Avec André JOUBERT, qui remarque que la présence des CONSTANTIN à Varennes n'a duré que cinquante ans, nous dirons que la famille LA TULLAYE est arrivée aux environs de 1684, date confirmée par l'acte de baptême à Savennières de Louis Salomon de LA TULLAYE, seigneur de Varennes le 27 octobre 1691.
Les LA TULLAYE sont originaires de Bretagne où ils sont connus depuis au moins deux siècles pour les services rendus à leur province.
La branche de Varennes descend de Salomon de LA TULLAYE (1599-1677) qui épouse en secondes noces Françoise MARTINEAU (fille de Nicolas MARTINEAU et Perrine AVRIL). Leur fils (ou petit fils), Salomon François (1653-1726) se marie en secondes noces avec Anne ROGIER de CREVY ; il est procureur général de la Chambre des comptes de Bretagne, quand naît à Savennières son fils, Louis-Salomon de la TULLAYE, lequel va marquer de son empreinte sa présence à Varennes et dans la paroisse.
Les registres paroissiaux donnent une longue liste d'événements familiaux : 23 juin 1706 : mariage de Marie de LA TULLAYE avec Nicolas de GRIGNON, marquis de POUZAUGES. 4 janvier 1723 : Mariage de Louis Salomon avec Pauline VOLAIGE de CIERZAY. 20 mai 1725 : Baptême d'Anne Pulchérie.
11 juillet 1726 : sépulture de François Salomon de LA TULLAYE 13 septembre 1726, pose de la première pierre de l'autel "à la romaine" dans l'église de Savennières par la veuve de François Salomon, Anne ROGIER de CREVY qui meurt deux ans après, le 6 avril 1728.
2 juin 1728 : pose de la première pierre de la sacristie à Savennières par Pauline VOLAIGE (à noter que le curé MENARD écrira sur le registre avoir fait poser "à ses frais la porte sur le dehors de la sacristie" en 1772).
26 novembre 1743 : baptême d'une cloche dont la marraine est Marie-Anne de LA TULLAYE. Pendant que Pauline de LA TULLAYE s'occupe de ses enfants, au moins six, dont deux paires de jumeaux, Anne (1725), Louis Salomon et Marie-Mélanie (1734), François et Hélène Pulchérie (1736), René (1741), son mari fait moderniser et agrandir le château et les dépendances pour obtenir l'élégant ensemble dont un dessin au crayon un siècle plus tard nous montre l'ordonnance.
En 1875, il a été retrouvé dans une cave un tuffeau portant cette inscription: "Primum hujus aedificie lapidem, necessarium domum Baccho aedificando, posuere noblissimus dominus Lud-Salomon de la Tullaye, dominus de Varennes, de Cierzay, de Chatillon, de la Motte, de la Chapelaye et nobilis et dilectissima conjux M. Volege" En 1734, est construite la chapelle dans le parc à trois cents mètres environ au nord des bâtiments, en forme de tour ronde surmontée d'un dôme à lanternon dans le style de celui qui termine la tour du château.
C'est aussi au cours de cette période que le parc est mis au goût du jour. Une description succincte nous est donnée par l'acte de vente, soixante ans après, en 1794. Il est composé : d'une cour d'entrée bordée d'une remise et d'un petit jardin, planté d'arbres ; dans la cour, escalier pour monter vers une seconde cour dans laquelle est un parterre et une terrasse. Jardin potager de 5 boissellées environ avec un puits et une grande orangerie, grenier au-dessus, au couchant de la maison une basse-cour, au nord et au couchant un grand parc clos de mur garni en partie d'espaliers, environ 17 arpents dont 12 plantés en vigne et le reste en bois avec plusieurs allées de charmilles et tilleuls, puits, pompe. Environ deux quartiers de vignes de cinquante chaînes, chaque quartier planté en rouge et blanc situé au midy de la maison.
Dans cette énumération, on retrouve la structure des parcs dessinés aux XVIe le et XVIIIe siècles dans les grandes demeures de l'Anjou : la cour avec terrasse, le jardin d'agrément avec ses parterres quadrilatères, le potager, le verger, l'orangerie, la vigne, les remises, la basse-cour et, avec comme base datant des siècles précédents, l'étang pour la pêche, le bois utilisé comme réserve de combustibles et de gibier (la maison des biches au fond du parc de Varennes en est un souvenir) le tout entouré de murs, la Loire donnant une perspective étendue vue de la terrasse. C'est aussi de cette époque que doit dater la « glasserie » (n° 204 sur le premier cadastre), bâtiment de 50 m2 dans lequel on emmagasine des blocs de glace quand il gèle pour les utiliser en été. Il en existe un dans le parc voisin.
C'est donc dans un environnement embelli que les enfants LA TULLAYE se marièrent : en 1746, Marie-Anne avec le sieur TEXIER, en 1756, à Savennières, Marie-Mélanie avec LE TOURNEUR, en 1761, Hélène Pulchérie avec Pierre de RECHIGNEVOISIN.
Comme tout propriétaire, Louis Salomon s'occupe de son domaine à Savennières et de celui de son épouse Pauline à Cierzay ,il signe les baux avec ses fermiers et métayers.
À ses occupations journalières et familiales, il ajoute sa participation aux séances de l'Académie d'Anjou dont il est un des trente membres titulaires et aussi chancelier. Élu au cours de la séance du 17 mars 1731 au 3e fauteuil où l'a précédé l'évêque d'Angers Mgr Michel PONCET de la RIVIERE, son éloge fut prononcé le 25 avril 1770 par DUVERDIER de la SORINIERE.
Louis Salomon et son épouse Pauline décèdent à Varennes à un an d'intervalle - 7 août 1769 et 28 octobre 1770 - laissant la propriété à leur fils René Henri, conseiller au Parlement de Rennes, marié à Élisabeth Geneviève LEVI.
Au propriétaire terrien succède l'homme d'affaires, si l'on en juge par les papiers conservés aux archives, ce qui ne l'empêche pas d'être l'un des 40 membres titulaires, dès sa fondation en 1777, de la Société des Botanistes et Chimistes ou Société d'histoire naturelle de l'Anjou.
En 1790 à Nantes avec un associé, Monsieur DROUET, il fait de l'import-export expédiant des articles aussi divers qu'un service de faïences anglaises comprenant 12 douzaines d'assiettes plates, 3 douzaines d'assiettes creuses, 12 tasses à chocolat, soupières, saladiers, etc..., ainsi que du sucre expédié en barrique par bateau.
Il travaille avec des clients dans toute l'Europe, Amsterdam, Aix-la-Chapelle, Berlin, Vienne, Dresde, Strasbourg, et la dévaluation de la monnaie française lui pose de nombreux problèmes de variations de change.
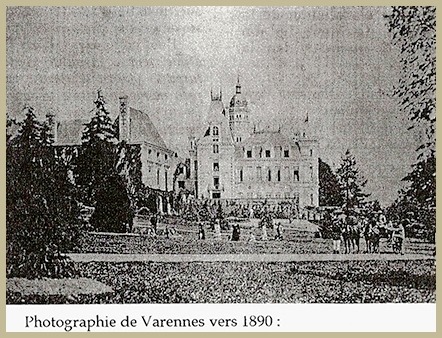
La maison d'Angers, rue du Puits-rond, est imposée en 1789 à 'impôt supplémentaire de MM. les privilégiés. La tempête révolutionnaire n'épargne pas René-Henri de LA TULLAYE : le seizième jour du quatrième mois de l'an II (5 janvier 1794), il meurt dans les prisons républicaines à Doué-La-Fontaine Son seul enfant, René Albert de LA TULLAYE, figure sur la liste des émigrés. Le domaine de Varennes est classé bien national et mis aux enchères le 12 prairial an II au prix de départ de 25 300 livres.
Timidité ou plus probablement manœuvre, pendant que brûlent les 3 bougies réglementaires, aucun acquéreur n'enchérit et il en est de même pour les quatorze lots suivants appartenant à Albert de LA TULLAYE. Dix jours après le 10 juin 1794, nouvelle séance. Le premier lot, le plus important, qui comprend les bâtiments cour, jardins et les terres entourées de murs dont le produit est estimé à 1 265 livres est mis à prix à 25 300 livres (les trumeaux et les tapisseries de papier font partie de l'adjudication).
Dès le 1er feu, le citoyen Ragot offre 26 000, Coutard : 30 000, Lizambert : 45 000 puis 52 000, 60 000, 69 000, Esnault 70 000. Quand Joseph Vincent Rousseau lance 72 000 livres, le second feu s'éteint sans surenchère, "adjugé à J.V. ROUSSEAU demeurant en cette commune pour 72 000 livres plus 1 440 livres de frais". Les lots suivants sont adjugés dans la même journée à des acquéreurs, tous déclarés habitants dans la commune : J-V. ROUSSEAU achète deux autres lots : le bois de Bignonnet (mise à prix 675 l, dernière enchère 1199 livres) et 16 boisselées de terre (environ 1 ha) (mise à prix 600 l, dernière enchère 2100 livres).
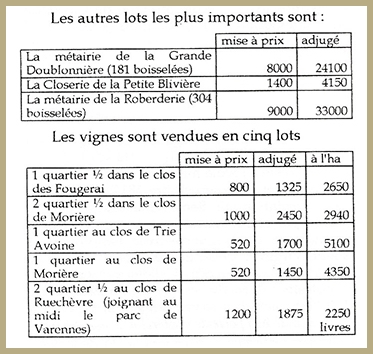
Le quartier de vigne à Savennières valait 50 perches carrées, soit 32 ares 95, le prix à l'hectare varie de 2250 à 5100 livres, les parcelles les mieux exposées ayant les prix les plus élevés.
Joseph Vincent ROUSSEAU ne profite pas longtemps de son acquisition, car il décède cinq ans après, le 22 juin 1798 à Nantes des suites des blessures reçues pendant l'insurrection vendéenne. Son fils Lucien écrit que «son père n'avait acheté Varennes que pour le rendre à l'ancien propriétaire, qu'il avait été trouvé sous le pressoir et dans la chaussée de l'étang, une sacoche d'argent et de l'argenterie déposée par M. de LA TULLAYE père et que tous ces objets avaient été remis à son fils qui servait alors dans l'armée royaliste».
En juillet 1799, la veuve de Joseph Vincent ROUSSEAU de LA BROSSE, signe avec René Albert de LA TULLAYE, une convention qui transmet sans retour et avec garanties à la dite veuve ROUSSEAU, tous les droits quelconques qu'il peut et qu'il pouvait avoir aux dits biens moyennant la somme de vingt mille francs écus. René Albert de LA TULLAYE sert sous Bonaparte comme officier d'état-major dans l'armée d'Italie et meurt sans descendance à ANGERS le 29 octobre 1820 à l'âge de 40 ans.

XIXe siècle : Les ROUSSEAU de La BROSSE
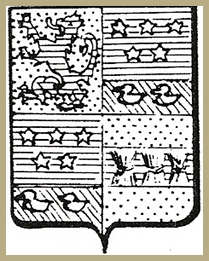 En 1794, Varennes change donc de propriétaire avec l'arrivée de J.V. ROUSSEAU que l'acte de vente du 10 juin dit domicilié à Savennières (tous les acheteurs qui ont enchéri sur les propriétés des LA TULLAYE ce jour-là sont dits domiciliés à Savennières).
En 1794, Varennes change donc de propriétaire avec l'arrivée de J.V. ROUSSEAU que l'acte de vente du 10 juin dit domicilié à Savennières (tous les acheteurs qui ont enchéri sur les propriétés des LA TULLAYE ce jour-là sont dits domiciliés à Savennières).
Or l'État civil nous indique que les ROUSSEAU habitent Angers ou Nantes. Joseph Vincent ROUSSEAU, fils de l''honorable homme Pierre ROUSSEAU, marchand, et de demoiselle Jacquine JAUNAI, a été baptisé le 5 avril 1753 dans la paroisse Saint-Pierre d'Angers après son frère Pierre (18 mai 1749) et ses deux soeurs : Jacquine (2 avril 1750) et Perrine (21 février 1752). Il est certain que Vincent ROUSSEAU s'est marié à Nantes le 12 mars 1792 avec une jeune fille de vingt ans plus jeune que lui, Anne FAVRE, née à Couvet en Suisse le 1er mai 1773.
Le Dictionnaire biographique nous apprend que la famille FAVRE, protestante, originaire de Bourg-en-Bresse, s'est réfugiée en Suisse après la révocation de l'Édit de Nantes. Elle compte parmi ses membres Claude FAVRE De VAUGELAS, (1585-1650), académicien et grammairien réputé, un des auteurs principaux du 1er dictionnaire de l'académie Française. Anne FAVRE a un frère, Ferdinand COUVERT (1779-Paris 1868), qui fut maire de Nantes sous la monarchie de Juillet puis député de la Loire Inférieure en avril 1848 et qui participa en tant que maire à l'arrestation de la duchesse de Berry. À l'époque de son mariage, Vincent ROUSSEAU est négociant armateur et devait être en relation avec Henri de LA TULLAYE.
De son mariage, il eut deux enfants, Sophie Joséphine Virginie née le 20 avril 1793 et Joseph Lucien né à Nantes le 10 mai 1796. L'acte de naissance de ce dernier précise que son « père négociant est absent depuis cinq mois environ pour ses affaires » et que son oncle maternel est "fabricant d'indiennes". La tradition familiale est que le père absent avait rejoint l'armée vendéenne et qu'il est décédé le 22 juin 1798 (messidor an VI) des suites de ses blessures. La grand-mère de Lucien, Jacquine JAUNAI-ROUSSEAU, aurait fait partie du convoi de femmes que le Comité révolutionnaire d'Angers a envoyé à pied à Paris, mais dont un grand nombre sont mortes d'épuisement dans la cathédrale de Chartres transformée en prison.
En 1798, Madame ROUSSEAU, née Anne FAVRE, se retrouve à 24 ans veuve, mère de deux enfants mineurs et gérante de leurs biens, dont Varennes. Plusieurs sources, les états de service militaire de Lucien et la plaidoirie du procès qui opposa les enfants ROUSSEAU à leur mère et à son deuxième mari, donnent une idée de ce que fut la jeunesse de Lucien pendant les premières années du XIXe siècle ; années très mouvementées tant sur le plan militaire que politique.
La carrière militaire de Lucien ROUSSEAU de La BROSSE fut courte et exigea de la diplomatie et beaucoup de souplesse. Quelques jours après la défaite des armées napoléoniennes à LEIPZIG, il entre le ter novembre 1813 à l'école militaire de cavalerie de Saint-Germain et deux mois après, le 27 décembre, par une lettre adressée à "Sa Majesté l'Empereur et Roi" il sollicite une "sous-lieutenance au 9e Hussards" demande refusée le 31 janvier, car il n'existe point d'emploi vacant au 9ème Hussards .
Le 4 avril 1814, abdication de Napoléon à Fontainebleau, Louis XVIII monte sur le Trône. Lucien, resté à l'école militaire, est promu sous-lieutenant et le 16 septembre 1814, il demande une affectation au 5e chasseurs BOURBON , par une lettre adressée à son Excellence le ministre de la guerre avec l'appui de sa soeur Virginie, devenue par son mariage, la baronne de CAZALS. Celle-ci présente ainsi son frère : "Fils du sieur ROUSSEAU de LA BROSSE, mort dans la Vendée au service du Roi, le Duc de Bourbon porte de l'intérêt à ce jeune homme qui s'est bien conduit au passage de son Altesse Royale, le Duc d'Angoulême".
Le 12 octobre 1814, il reçoit son affectation au Sème Chasseurs à cheval. Mais le 20 mars 1815, revenu de l'île d'Elbe, Napoléon est aux Tuileries. Heureusement, il décide le 24 mars de confirmer dans leur grade tous les officiers nommés par le Roi. Lucien demande immédiatement à réintégrer l'armée et se fait appuyer cette fois-ci par le major-général de la 6e division militaire qui écrit « C'est un officier de mérite rare, d'une honnête famille, il est singulièrement attaché à Sa Majesté l'Empereur ; quoique jeune, il a déjà donné beaucoup de preuves de sa bravoure et de son zèle.»
Le sous-lieutenant participe alors à la Campagne de France et de Belgique, prend part, à Waterloo, à l'attaque du moulin de Biergé, le 18 juin 1815, et est blessé à la jambe gauche à l'affaire de Versailles. C'est la défaite. Les militaires sont renvoyés dans leur foyer. De Perpignan où il était en garnison, Lucien est licencié et envoyé à Angers.
Dans le rapport de licenciement, l'inspecteur général porte les annotations suivantes :
- Éducation : soignée, ce jeune homme promet de devenir un bon officier.
- Moralité : bonne.
- Principe : de famille noble très attachée au Roi. Fortune : aisée.
- Physique : très bel homme.
- Opinion : bonne éducation, assez bonne conduite, un peu négligent pour son métier.
- La note finale, donnée par le Colonel, est plus enveloppée : « bonne exécution, très bonne conduite, a mérité l'estime de ses chefs, désire continuer le service, son père mort» Lucien recevra une demi-solde jusqu'en 1823 de 575 francs par an.
Le dernier état de service mentionne : «10 ans 9 mois, y compris une campagne.» Demi-solde du 03.12.1815 au 18.07.1823. Bel officier, il figure parfaitement dans le rang.
Sur le plan familial, la vie du jeune Lucien ne fut pas facile non plus. Deux mois après le décès de son père, Anne FAVRE, sa mère, se fait nommer tutrice de ses deux enfants et, sur les conseils du sieur DROUET, co-tuteur ainsi que du sieur FRESNAIS, et en oubliant de faire désigner un conseil de tutelle, elle se fait attribuer la fortune de ses enfants. Ainsi, il n'y aura pas d' inventaire des biens meubles de Varennes où se trouvaient les meubles, les bijoux, les chevaux, trois voitures de maître, des bestiaux, des orangers et aussi les meubles de la grand-mère paternelle.
Les immeubles sont évalués à des prix très au-dessous de leur valeur par des experts choisis par Aimé FAVRE (en francs) :
- En Loire inférieure la Coeslerie 2000
- La Bucherie 1692
- Le Chalonge 4435
- En Maine-et-Loire Varennes 16170
- La Genvrie 6740
- La Brosse 3200
- À Angers les maisons rue Courte 1200
- Rue Saint-Michel 2400
En août 1800, Anne FAVRE se remarie avec François Bonaventure FRESNAIS, chevalier de la BRIAIS, le fils de son conseiller, mariage sous le régime de la communauté des biens. Peu à peu, les biens des jeunes ROUSSEAU sont vendus.
En octobre 1802, Varennes est vendu au comte Louis DUBOIS, ancien conseiller d'État, préfet de police de Paris, parrain de Virginie ROUSSEAU. Les enfants sont mis en pension, le comte DUBOIS paie la pension et laisse les revenus de Varennes à Anne FAVRE pour entretenir la propriété. En 1811, Varennes est revendu à Anne FAVRE.
Lorsque Virginie est demandée en mariage, son beau-père accepte finalement de la doter, parce que le futur mari, le baron de CAZALS, lui facilite l'obtention du poste d'entreposeur principal des tabacs du département de Maine-et-Loire Lucien ROUSSEAU envisageant de se marier écrit : « FRESNAIS accepte de signer ma demande de permission de mariage (étant officier, il devait obtenir l'autorisation du Ministre de la Guerre), car la petite-fille de l'amiral VERNON, appartenant par sa mère à la famille MURRAY, était un choix qui ne pouvait que m'honorer, mais trouve le parti inconvenant lorsqu'il fut question de me restituer une part de l'héritage de mon père.»
En 1818, Lucien et sa soeur (devenue en secondes noces comtesse TAILLEPIED de BONDY), après une conciliation sans résultat, assignent leur beau-père devant le tribunal de Nantes qui condamnera ce dernier à restituer Varennes à ses légitimes propriétaires.
Le jugement fut confirmé en appel, puis en cassation. Lucien ROUSSEAU de LA BROSSE se marie le 14 janvier 1818 à Angers avec Sophie TYRREL née à Campvère en Hollande, le 9 novembre 1797, fille de feu Edouard, gentilhomme, capitaine de vaisseau et Marguerite MURRAY en présence du Préfet de Maine-et-Loire, le baron de WISMES, Émile FAVRE, Antoine LELONG, le comte d'ANDIGNE, Claude-René ROUS SEAU, prêtre.
Les mères des deux époux sont domiciliées Quai Royal à Angers. Le 23 août 1825, à Nantes, en l'étude de Me GICQUEAU, le partage de la succession de Vincent ROUSSEAU entre ses deux enfants permet à Lucien d'entrer en possession de Varennes et de ce qui reste de la fortune de son père.
Il reçoit Varennes, mais doit verser une soulte de 17 000 F. à sa soeur Virginie. Sa femme avait reçu en dot 24 000 francs de sa tante Sophie TYRREL.
Le couple s'installe et met au monde six enfants, quatre filles entre deux garçons. Charles 1820, Caroline 1822, Mathilde 1824, Valentine 1827, Valérie 1832 et Lionel en 1842.
Les recensements de 1836, 1841, 1851, indiquent que vivaient aussi à Varennes, un précepteur : Joseph LE BARBIER, une cuisinière : Françoise POILASNE et deux jardiniers.
Les dessins et aquarelles de l'époque montrent un ensemble de bâtiments en fer à cheval autour d'une terrasse surplombant la Loire avec parc, jardins, verger, vignes, tels qu'ils avaient été conçus au siècle précédent par les LA TULLAYE et tels que sont encore actuellement le bâtiment central et l'aile gauche.
Le domaine s'agrandit : le 27 octobre 1832, achat du clos de Varennes (2 ha 86) à la famille LEBRUN ; le 24 février 1835, la maison des Forges qui appartenait en indivis à la famille WITWOET à Coulaines et au Dr. LAUMONNIER à Chalonnes ; le 24 janvier 1847, deux parcelles de 5 ares et 1 are en roche à l'angle des Coulées, à la commune. Une importante modification due à la construction de la voie ferrée en 1846 rattache les terres situées sur l'île de Savennières à la rive droite de la Loire et ferme à la navigation la boire de Savennières (2 ha 55).
Les journées révolutionnaires de 1830 réveillent les sentiments militaires de Lucien ROUSSEAU qui écrit à M. le Ministre de la Guerre demandant à être employé dans le grade de lieutenant de gendarmerie à Angers. Il expose ses arguments : licencié en 1815, emprisonné au château d'Angers le ter juillet 1816 par ordre du lieutenant général d'AUTICHAMPS qui avait demandé une déportation, je me suis retiré dans ma famille sans demander de service sous le gouvernement de la Restauration,
Le 26 juillet 1830, je me suis rendu à Angers pour défendre la ville contre les troupes de la garnison. Le 30 juillet, j'ai été à Nantes , j’ai fait organiser la garde nationale en arborant le drapeau tricolore dans les communes de SAVENNIERES et BEHUARD, malgré la résistance des adjoints.-
J’ai fait aussi afficher toutes les proclamations. Ayant contribué de tous mes moyens et de toute mon influence dans le pays pour faire triompher la cause de la liberté et maintenir la tranquillité, je me crois quelques droits à demander d'être porté sur le cadre des officiers de l'armée et d'être employé dans le grade de lieutenant de la Gendarmerie... j'ai quatre enfants dont l'aîné n'a que dix ans et je ne puis abandonner la surveillance de leur éducation.
Cette demande est appuyée par le comte DEJEAN, le comte de BONDY, questeur de la chambre des députés, le marquis Paul d'ANDIGNE, député de Maine-et-Loire. Apparemment, la demande ne fut pas agréée, mais Vincent ROUSSEAU de LA BROSSE obtint cependant le commandement des gardes nationales du canton de Saint-Georges-sur-Loire avec le grade de colonel, en 1852.
L'incarcération au château d'Angers en 1816 fait suite à l'affaire de Versailles où le jeune lieutenant fut blessé à la jambe gauche au cours d'un duel entre officiers de l'Empire en demi-solde et officiers de la nouvelle garde royale de Louis XVIII. Cette aventure a certainement nuit à la carrière de Lucien ROUSSEAU de LA BROSSE, surtout en ce dix-neuvième siècle où la fidélité à un gouvernement était très mal vue par le pouvoir suivant.
Néanmoins, les années passent au gré des changements de régime et des événements familiaux : naissance du sixième enfant Lionel, 22 ans d'écart avec son frère aîné, mariage deux mois après, le 21 mai 1842 à Nantes de Caroline avec Philippe, Auguste BARRAT ; Mathilde Rose, mariée avec un Irlandais, William ARMSTRONG de MEALIFFE, perd son fils de 5 ans enterré à Savennières ; Léontine Valérie épouse Joseph Gabriel de KERGARIOU en 1855.
La Chapelle et l'Enfeu.
(enfeu : caveau funéraire pratiqué dans une chapelle pour y recevoir des tombes).
Le décor de la chapelle de Varennes appartient à l'école lavalloise, puis angevine, des grands retabliers qui opèrent durant tout le XVIIe siècle. La relative exiguïté et la forme octogonale des lieux n'ont pas permis ici le déploiement habituel d'ensembles monumentaux régulièrement adossés à un mur, mais ont obligé les sculpteurs à concevoir trois volets d'un même ensemble sur trois pans différents.

Celui du centre est occupé par l'autel surmonté par deux colonnes et deux pilastres en marbre noir. La base inférieure des colonnes, en pierre, est sculptée d'enroulements de feuillage peints alors  que sur l'entablement court une très dense frise d'enroulement doré. Au sommet de la composition apparaît une représentation du visage de Dieu le Père. Le tableau qui occupe le centre de cette architecture représente l'assomption de la Vierge Marie.
que sur l'entablement court une très dense frise d'enroulement doré. Au sommet de la composition apparaît une représentation du visage de Dieu le Père. Le tableau qui occupe le centre de cette architecture représente l'assomption de la Vierge Marie.
Il s'agit d'une copie partielle (les Apôtres) de l'oeuvre de Simon Vouet (1590-1649) actuellement conservée au musée de Reims. De part et d'autre du retable de l'autel, sont disposées deux compositions presque similaires. Chacun de ces grands tableaux verticaux ainsi composé est rempli par un décor de chute de trois gros bouquets de fleurs retenus par un ruban plissé aux attaches dissimulées par des chérubins.
Au centre, deux scénographies surprennent par leur originalité, car rarement deux angelots assis sur un fronton semi-circulaire et encadrés de lourdes guirlandes de chute de fruits et de fleurs forment l'ensemble d'un décor latéral. Le spectateur ne peut être que surpris par le caractère affligé des chérubins et angelots qui, au nombre de onze, figurent sur ce décor aux couleurs du deuil, noir et blanc, assorti d'or.
Décèdés, à un an d'intervalle, des deux frères commanditaires pourrait en être l'explication. Un des soucis de Lucien ROUSSEAU de LA BROSSE, souci partagés par de nombreuses familles au cours du XIXe siècle, a été de donner à ses ancêtres une sépulture durable, perpétuelle et à l'image de la notoriété des occupants.
Il y avait à Varennes une chapelle depuis fort longtemps : l'acte de vente du 29 janvier 1663 mentionne une réserve pour le prix de la chapelle ; mais il s'agissait peut-être d'une fondation de chapelle sans érection comme celle fondée en 1554 à Savennières pour 200 ans ou celle de Jeanne MARTINEAU le 3 février 1670. Cependant, en 1683, le baptême de Jeanne Olympe BINET fut célébré en la chapelle seigneuriale de Varennes. La chapelle actuelle fut édifiée par Louis Salomon de LA TULLAYE en 1734, telle qu'on la distingue sur les aquarelles du début du XIXe siècle.
La décision d'en faire une sépulture de famille en incombe à Lucien ROUSSEAU et à sa soeur sur les instances de leur mère en 1815. La surface de la tour fut agrandie par l'édification d'un mur de deux mètres surmontés, d'une terrasse sur la façade et en creusant le roc à l'arrière. Le haut de la tour restant inchangé fut recrépi et les armoiries stylisées des ROUSSEAU de LA BROSSE et des TAILLEPIED de BONDY sculptées au-dessus de la porte. Le dôme et le lanternon sont couverts en ardoises ; de grandes marches de schistes permettent d'accéder au-dessus du caveau, à la chapelle proprement dite.

L'intérieur comprend un autel surmonté d'un retable de style baroque avec deux angelots coloriés et deux vitraux offerts vers 1910 en souvenir de Gordon PIRIE et de son épouse. Un espace de 630 m2 a été réservé pour permettre aux chars d'accéder jusqu'à la porte du caveau et des cyprès furent plantés pour en marquer la limite.
Il avait été tenu compte de l'indivision perpétuelle du monument lors du partage de la succession de Vincent ROUSSEAU de LA BROSSE. Dès la succession de Lucien, cette disposition fut mise en question, puis réglée par l'abandon de tous les droits sur le caveau à Charles de LA BROSSE.
Un acte de 1857 précise que le caveau est occupé par les cercueils d'Anne FRESNAIS de la BRIAIS, veuve de Vincent ROUSSEAU de LA BROSSE, du comte TAILLEPIED de BONDY, des trois jeunes enfants de Madame de BONDY, Madame TYRELL, mère de Madame ROUSSEAU de LA BROSSE. Plusieurs défunts des familles ROUSSEAU et PIRIE ont été inhumés, les derniers devant être Monsieur et Madame Duncan Vernon PIRIE en 1931 et 1934.
Depuis, les cercueils et les urnes ont été transférés au cimetière de Savennières dans le caveau familial. Lucien ROUSSEAU de LA BROSSE meurt à Varennes le 5 octobre 1857, il fut inhumé dans la chapelle ainsi que son épouse un an après, le 9 octobre 1858. Un jugement du tribunal d'Angers ordonne la vente par licitation en raison de la présence d'un mineur, Lionel. L'aîné, Charles, se porte acquéreur pour cent quinze mille francs, mais une surenchère ayant été formée, la propriété est de nouveau soumise à l'adjudication et Charles a été déclaré adjudicataire moyennant la somme de 164 900 francs.
Le nouveau propriétaire, percepteur, s'installe à Varennes après s'être marié à Londres en 1860 avec Henriette KING. Il participe à la vie de la commune puisque le 25 septembre 1870,il est présenté par le maire à la compagnie de la garde nationale de Savennières avec le grade de capitaine, ayant pour adjoints Alexandre DURANCEAU, lieutenant, les sous-lieutenants Michel POIDEVIN et Robert de JOURDAN, les sous-officiers Pierre MENARD, Marc ESNAULT, Marc BOUET, Jean MARTIN, Paul MERLET, Charles FROMAGEAU. Les Prussiens ne sont pas venus à Savennières.
Mais en 1867, son frère Lionel avait quitté la France avec Jane Isabella HILL , fille de révérend John HILL, vicaire en Irlande, pour s'installer en Nouvelle Zélande auprès d'Auckland avec pour seuls bagages leur fils John Lucien, mille livres anglaises et une douzaine de petites cuillères en argent. Difficultés financières ou surveillance tatillonne des Renseignements généraux du Second Empire.
Peut-être les deux.
L'immigration a dû avoir un résultat positif puisque le frère aîné suivit l'exemple et gagna la Nouvelle Zélande après avoir vendu Varennes à son beau-frère en 1875.
La France adopte une nouvelle constitution, Varennes devient propriété écossaise pour un siècle.

XXe siècle : LES GORDON PIRIE
La grand-mère des enfants ROUSSEAU de la BROSSE, Margaret MURRAY, veuve d'Edouard TYRREL, était écossaise et habitait Aberdeen où elle avait un frère avocat, James MURRAY. Quand elle r ecevait ses petites filles, "les lys de la Loire" comme on les appelait alors, elle invitait les jeunes gens de la ville, dont Gordon PIRIE et ses frères. Valentine se marie la dernière le 21 février 1856 avec Gordon PIRIE, septième enfant de Alexander PIRIE et Anne LOGIS, ancien élève du Marishal Collège, membre de Queen's Body Guard for Scotland. Lorsqu'un visiteur se présente à Varennes, il peut voir, sculptées sur la tour, des armoiries dont une qui porte "d'azur à trois poires feuillées de même".
ecevait ses petites filles, "les lys de la Loire" comme on les appelait alors, elle invitait les jeunes gens de la ville, dont Gordon PIRIE et ses frères. Valentine se marie la dernière le 21 février 1856 avec Gordon PIRIE, septième enfant de Alexander PIRIE et Anne LOGIS, ancien élève du Marishal Collège, membre de Queen's Body Guard for Scotland. Lorsqu'un visiteur se présente à Varennes, il peut voir, sculptées sur la tour, des armoiries dont une qui porte "d'azur à trois poires feuillées de même".
À l'origine, les armoiries qui figurent sur le bouclier des hommes d'armes du Moyen-Âge étaient un moyen de reconnaissance dans les combats et les chevauchées, d'où l'utilisation de couleurs et de meubles rappelant le pays ou le nom de celui qui le porte. La poire, meuble assez rare, fut celui adopté par la famille POIRIER originaire du Berry : un échevin de Bourges en 1518.
Cette famille dut s'exiler à la suite de la révocation de l'édit de Nantes (1685) et partir jusqu'au nord de l'Écosse, à Aberdeen, grande ville de 150 000 habitants, choisie en raison de son université et de son activité maritime et commerciale. Après quelques générations en Écosse, son nom s'est transformé en PIRIE. Plusieurs familles portent encore ce nom en Écosse.
Les ancêtres proches de Gordon PIRIE, son grand-père Patrick, son père Alexander (1778-1860) étaient fabricants de papier. Ils dirigeaient une usine à papier à Stoneyword, sur la rivière Dee, à quelques kilomètres au nord d'Aberdeen ; c'était du papier de haute qualité et l'usine a été administrée par la famille PIRIE jusque vers 1930 quand elle a été achetée par une grande compagnie industrielle qui continue à faire tourner l'usine actuellement.
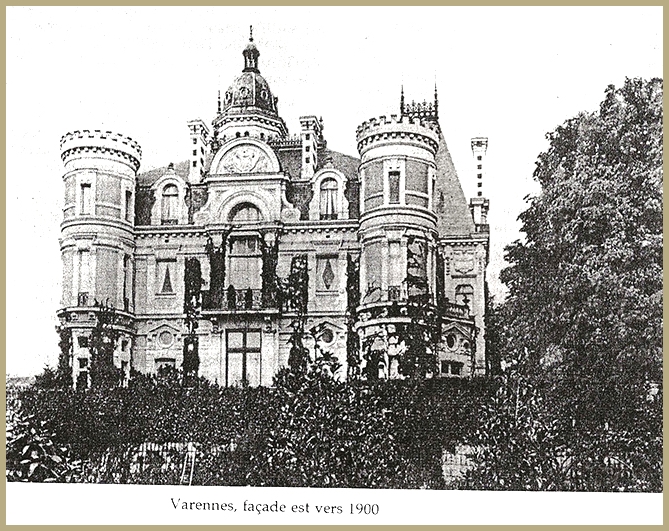
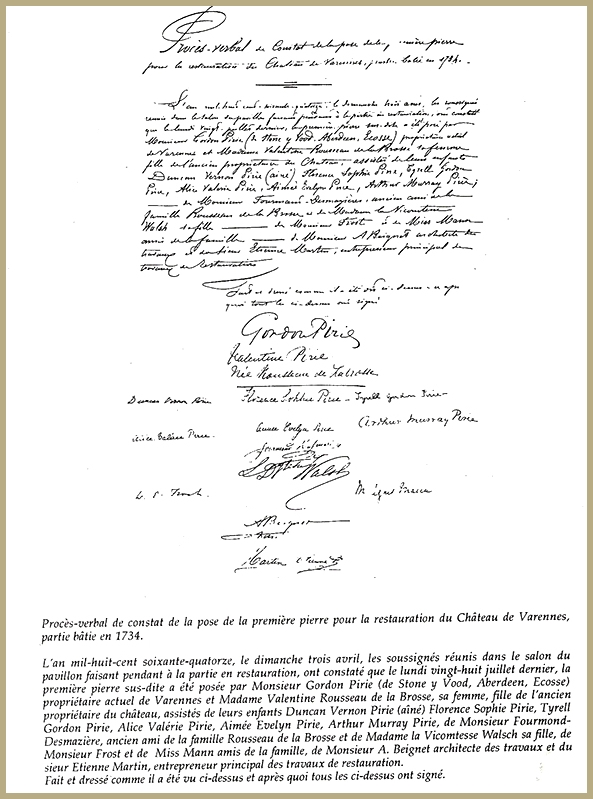
Le jeune couple s'installe en Écosse et ils eurent six enfants de 1858 à 1869, Duncan Vernon, Florence Sophie, Tyrell Gordon, Alice Valérie, Aimée Evelyn et Arthur Murry. Gordon continue à travailler dans l'entreprise paternelle, mais lorsque son beau-frère Charles ROUSSEAU de La BROSSE annonce son désir de vendre Varennes, il se porte acquéreur.
L'acte de vente est signé chez Me LORIOL de BARNY, notaire à Angers le 4 février 1874. La propriété comprend :
- 1) le château et ses dépendances : servitudes, cours, chapelle et caveau sépulcral, fontaine, pièces d'eau, boire, îles, prés, bois, taillis et futaies, orangerie et jardin potager entourés de murs 11 ha 81,70
- 2) la maison des Forges et ses servitudes, cour, jardin, verger 0 ha 30,67
- 3) un clos de vigne nommé clos du Parc 9 ha 00,00
- 4) une parcelle de terre et jardin nommée la Fuie 0 ha 31,20
- 5) un clos de vigne nommé le Clos de Varennes 2 ha 86, soit un ensemble clos de mur de tous côtés, sauf sur le chemin de Savennières, d'une superficie de 24 ha 29,57
- 6) des immeubles situés dans l'île de Varennes : l'hôtel de la gare des Forges, un pré, des pièces de terre et luisettes 5 ha 72,80
- 7) des immeubles détachés, dans l'île Gohard et à "la petite roche " 1 ha 79,45, soit une superficie totale de 31 ha 81,82, y compris les tapisseries des salons, les pressoirs, deux tonnes à cuver le vin rouge, les portoires et tous objets réputés des immeubles par destination.
La vente est consentie et acceptée moyennant la somme de deux cent cinquante mille francs que M. Gordon PIRIE a de suite payée aux vendeurs. L'arrivée de Gordon PIRIE à Varennes fut très médiatisée. « Les journaux du temps » écrit Célestin PORT deux ans après dans son dictionnaire, annoncèrent l'arrivée d'Aberdeen à Nantes sur un steamer de 500 tonneaux à son nom et lui appartenant, avec sa famille, son médecin, de nombreux domestiques, bagages, meubles, bibliothèque, six chevaux, deux vaches, et 32 animaux divers.
Trois trains spéciaux transportèrent le mobilier. Gordon devait déjà bien connaître Varennes, car dès le 20 juillet 1874, il pose la première pierre pour la restauration du château en présence de ses six enfants, de M. FOURMOND-DESMAZIERES, maire de Savennières et sa fille, la vicomtesse WALSH, de l'architecte BEIGNET et d'Étienne MARTIN, l'entrepreneur principal des travaux de restauration. Célestin PORT écrit : « le château, à cette date, présentait cette particularité d'avoir ses servitudes et les pressoirs installés dans le principal corps au centre, tandis que les deux ailes servaient d'habitation, celle de gauche, terminée par un fronton bizarre accosté de deux tourelles avec dôme en ardoise, celle de droite formée d'une tour octogonale avec coupole et lanternon en pierre, incrustés en ardoise».
Cette description, écrite en 1878, alors que la restauration est terminée, ne correspond pas tout à fait aux dessins, aquarelles et photos du Varennes d'avant 1875, mais la disposition en U ouvrant vers la Loire a été conservée, seule l'aile Est qui avait un rez-de-chaussée et un grenier a été remplacée par un grand corps de bâtiment à trois étages, et même quatre dans certaines parties, avec 25 ouvertures à l'est et autant à l'ouest sans compter celles donnant sur la Loire.
. Auguste BEIGNET, architecte très en vogue, ayant participé à la construction de nombreux châteaux, maisons, monuments publics en Anjou, avait dû aller étudier sur place l'architecture des châteaux écossais. Les jardins fruitiers et floraux, le parc, la ferme furent restaurés aussi ; Gordon PIRIE veillait à tout. La vigne fut également l'objet de tous ses soins.
Le livre de recettes et dépenses tenu par le vigneron, qui faisait les vignes à l'heure et le vin à façon, montre que les 180 boisselées, en 1888, ont été presque entièrement détruites par le phylloxéra de 1890 à 1893 malgré les traitements au sulfure de carbonate de potassium et qu'en 1900, il n'y avait plus que 65 boisselées productives (soit une chute de 11 ha à 4 ha), (1 ha 16 boisselées de vigne).
Les principaux cépages (inscrits sur le livre) étaient le groslot, le pineau d'abondance, le pineau de Bourgogne, le gros plant, le pineau de la Loire, le gamay de Châtillon et, après le phylloxéra, le gamay sur Rupestris. De très nombreuses heures étaient occupées par l'apport d'engrais organiques, les balayures d' Angers, et de la vase de la Loire et de l'étang.
En 1890, la barrique de pineau est vendue 300 francs (soit avec le coefficient 18,626 : 5600 F actuels ou 25 F le litre), celle de gros plant 105 francs et les prix de la barrique de rouge variaient de 175 à 275 francs suivant les cuvées. Le 14 mai 1900, à 73 ans, Valentine ROUSSEAU de LA BROSSE meurt à Arno Ventnor (île de Wight).
Son mari Gordon PIRIE consigne ses dernières volontés dans un testament déposé à Aberdeen, le 25 mai 1900. Suivant la tradition écossaise, il laisse le château de Varennes, avec toutes ses dépendances et tous les animaux, chevaux, voitures, meubles, tableaux, livres, vins, matériels à son fils aîné Duncan Vernon PIRIE, membre du Parlement ou à défaut à son fils aîné Taldo ou à défaut de celui-ci à son second fils Alistair.
Un an après, le 26 juin 1901, Gordon meurt à Varennes. Le testament entraîne de nombreuses formalités et les cinq frères et soeurs de Duncan doivent reconnaître devant notaire en France que ledit testament «bien que ne présentant pas les conditions imposées par la loi française, doit être exécuté selon les volontés déterminées par Gordon PIRIE»
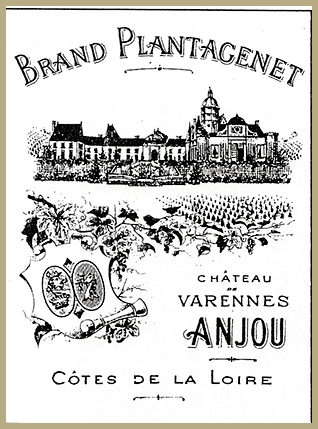 Le nouveau maître de Varennes est un homme occupé et qui a beaucoup voyagé, « une forte personnalité » disent ses enfants. Né le 22 mars 1858, élève au Trinité Collège à Glenalmond et au Clipton Collège. Membre de la Chambre des Communes, représentant le parti libéral pour Aberdeen nord, il siège de 1896 à 1918.
Le nouveau maître de Varennes est un homme occupé et qui a beaucoup voyagé, « une forte personnalité » disent ses enfants. Né le 22 mars 1858, élève au Trinité Collège à Glenalmond et au Clipton Collège. Membre de la Chambre des Communes, représentant le parti libéral pour Aberdeen nord, il siège de 1896 à 1918.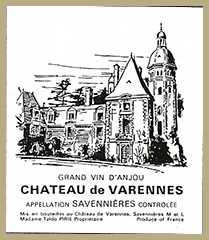
Lieutenant-colonel O.B.E., membre de la garde écossaise du Roi, il participe à la guerre d'Égypte en 1882, à l'expédition au Soudan (1884), à l'expédition sur le Nil (1885), à la guerre en Afrique du Sud en 1900 et à la première guerre mondiale en Grèce et en Serbie.
Entre-temps, il se marie le 7 juin 1894 avec Honorable Evelyn Courtenay, FORBES SEMPILL, fille du 17e Lord SEMPILL, dont il aura six enfants. Passionné par les plantes et surtout par les arbres, il achève à Varennes le travail de son père en plantant de nombreuses espèces rares qu'il n'hésite pas à faire venir de pays très lointains.
Cette collection, qui vient de faire l'objet d'un inventaire complet, est considérée par les spécialistes comme remarquable et digne de respect et de beaucoup de soins. Duncan Vernon effectuant de nombreuses allées et venues entre l'Écosse, le Parlement et Savennière, installa sa famille dans la maison des Forges et loua en octobre 1905 l'aile neuve du château à la famille de la FOREST DIVONNE, mais à peine un mois après, ce bâtiment fut la proie des flammes, incendie qui eut un grand retentissement dans la région.
L'incendie du 3 Novembre 1905
A la une du journal du soir : Le Maine-et-Loire du 3 novembre 1905, en grands caractères sur toute la largeur de la page, «l'incendie du château de Varennes», et en chronique départementale les détails : « Le château de Varennes à M. PIRIE GORDON aux Forges a été complètement détruit par un incendie dans la nuit de jeudi à vendredi.» À 20 h. M. de la FOREST DIVONNE, locataire depuis le 1er octobre, allait se coucher quand il entendit des craquements au second étage.Il n'a eu que le temps de faire sortir sa famille qui a été accueillie chez M. le baron BRINCARD. Le valet de chambre M. CHALOT courut à bicyclette chercher les pompiers de Rochefort.
Le sacristain sonnait les cloches, M. MESLET, adjoint, télégraphiait au commandant des sapeurs-pompiers d'Angers. «Les jets d'eau étaient impuissants contre les torrents de flammes qui s'échappaient de toutes les fenêtres, quand vers minuit les plafonds s'effondrèrent avec un fracas épouvantable, une immense colonne de flammes s'éleva, le spectacle était magnifique d'horreur». Sur place parmi les personnes accourues à la première heure, M. MARTIN-LABOUREAU, maire de Savennières, le clergé, MM. de CHEMELLIER, LEMARCHAND notaire. Monsieur LAURENT-BOUGERE, député, qui se rendait de La Possonnière à Paris aperçut, de son wagon ?, les flammes.
En gare d'Angers, il fit retarder le départ du train pour téléphoner aux pompiers, mais il lui fut répondu que les sapeurs d'Angers n'étaient pas assez nombreux pour se rendre aussi loin. Le vendredi matin, l'incendie continuait encore, un détachement du Génie sous les ordres d'un adjudant est arrivé par le train partant d'Angers à 9 h 57. Le journal du samedi 4 décembre précise que M. de la FOREST-DIVONNE estime ses pertes à 80 000 francs et que M. PIRIE pour l'ensemble de ses immeubles est assuré pour 300 000 francs et son mobilier pour 150 000 francs.
Le journal du lundi 6 novembre publie un télégramme de M. PIRIE, arrivé de Londres dimanche par le train de 4 heures à Angers : «je suis plus que touché du dévouement que chacun y a apporté, j'en ressens plus vivement les anciens liens qui m'attachent au pays et ce fait m'apporte une bien douce consolation dans mon malheur.» De tout cœur merci à mes amis de Savennières et de Béhuard ". Un message similaire de M. Charles Ludovic de la FOREST-DIVONNE parut dans le journal du lendemain.
Le 12 novembre, le conseil municipal témoigne ses condoléances les plus vives à M. VERNON PIRIE et forme le voeu au nom de tous les habitants de voir l'élégant manoir de Varennes renaître de ses cendres et se dresser comme naguère à l'entrée de Savennières pour la plus grande satisfaction des gens du pays (ainsi que des touristes et des promeneurs) et la rare beauté du paysage.
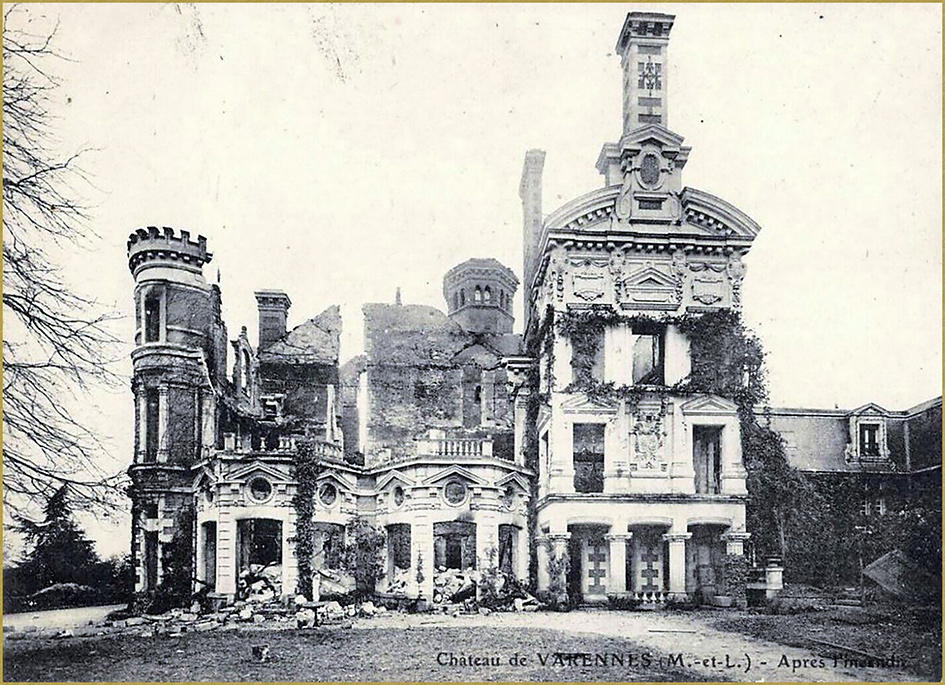
Les causes de l'incendie furent âprement discutées. Pour les experts,l'incendie est dû à ce que la cheminée de la chambre E au deuxième étage n'avait pas de tuyau d'échappement au dehors, mais donnait sous la charpente dont les bois ont été enflammés par suite du feu fait dans cette cheminée.
Le 17 novembre 1905, le Président du Tribunal autorisa les époux de la FOREST-DIVONNE à assigner Monsieur PIRIE jugé responsable de l'incendie. En réponse, ce dernier demanda au Tribunal de déclarer l'action des époux la FOREST-DIVONNE irrecevable et nulle.
En définitive, le 1er mars 1907, il fut jugé qu'il n'y avait aucune preuve certaine et que «l'origine doit être attribuée à une cause accidentelle, et en conséquence les locataires sont mal fondés à demander réparation du préjudice.» La Cour d'Appe,l en audience publique le 25 mars 1908, confirma ce jugement. M. de la FOREST-DIVONNE demandait 135 881 francs 75 de dommages, qu'il n'obtiendra pas.

La reconstruction du château de Varennes fut confiée en 1909 à MM. Charles GARIN et F.G. HENRY BANS, architectes angevins, demeurant à Paris, avec l'entreprise Pierre MENARD à La Possonnière comme maître d'oeuvre et pour la maçonnerie, l'entreprise J. MESLET JUVENAL et fils à Savennières pour la menuiserie et MOUTEL serrurier à Savennières pour les persiennes en fer. L'idée générale était que la construction projetée devait s'adapter aux bâtiments existants respectés par l'incendie, les anciens murs et fondations conservés dans la mesure du possible et reconsolidés.
Le devis descriptif indique que le socle au rez-de-chaussée sera en granit de Bécon, le carrelage de la salle des fleurs en carreaux rouges et blancs d'Auneuil (près de Beauvais), les socles du 1er étage et les chaînages du donjon en pierre de Lavoux (Poitou), les corniches, chambranles et claveaux en tuffeaux gris identiques à ceux du pavillon de gauche, les parquets de la salle à manger au rez-de-chaussée, du salon et de la grande chambre au ler, en chêne façon point de Hongrie, et en chêne à l'anglaise dans le fumoir. Les matériaux de démolition non réutilisés et tous les gravois devront être transportés dans le parc à l'endroit désigné par M. PIRIE.
La partie haute du donjon sera déposée pour être reposée à une hauteur inférieure. Les canalisations d'eau en poterie importée d'Angleterre conduisent l'eau depuis la source près du moulin du Gué jusqu'aux bâtiments d'habitation et d'exploitation et aux fontaines dans les jardins. C'est de cette époque que datent les inscriptions et armoiries figurant sur le grand bâtiment sur les colonnes encadrant la porte d'entrée.
On voit à gauche une tête surmontée de l'inscription ANGLETERRE et au-dessus les devises NEMO ME IMPUNE LICESSIT et DIEU et MON DROIT et en face, le mot FRANCE et HONNI SOIT QUI MAL Y PENSE-DIEU BENISSE LA FRANCE. Ainsi les deux nations accueillent les visiteurs, c'est l'entente cordiale.
Sur le donjon, dans deux cartouches ovales disposées en V, on retrouve à droite les armoiries des PIRIE : un buste de biche tenant une branche de poirier et à gauche, une tête de lion lampassé couronnée avec un sceptre et un bras armé d'une hallebarde ou clé sur une couronne de comte.
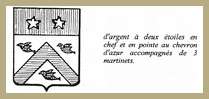 Sur la cheminée au Nord, sont les armoiries des MARTINEAU : entourées de deux masques de femmes, enfin, sur le mur nord-est, un écusson très abîmé où l'on devine deux lettres enlacées. Les travaux commencés en 1909 ne se terminent qu'en 1921. Beaucoup de mémoires des entrepreneurs ayant disparu, citons seulement : le mémoire de l'entreprise MENARD pour travaux exécutés sous la direction des architectes, montant : 91368 F.
Sur la cheminée au Nord, sont les armoiries des MARTINEAU : entourées de deux masques de femmes, enfin, sur le mur nord-est, un écusson très abîmé où l'on devine deux lettres enlacées. Les travaux commencés en 1909 ne se terminent qu'en 1921. Beaucoup de mémoires des entrepreneurs ayant disparu, citons seulement : le mémoire de l'entreprise MENARD pour travaux exécutés sous la direction des architectes, montant : 91368 F.
Le mémoire du menuisier MESLET : 11260 F
Le mémoire du serrurier MOUTEL pour les persiennes : 1 245 F
Il faudrait ajouter ceux des peintres, des électriciens, sans oublier les architectes dont les honoraires s'élèvent à 5 % plus 2,5 % pour les frais de déplacement, soit 7,5%.

La Guerre 14 -18
Au cours de la première guerre mondiale, Varennes fut occupé par un détachement du 6e génie. Les jeunes classes apprenaient à faire des tranchées et des casemates dans le haut du potager, à établir des ponts de bateaux sur la Guillemette et la Loire. L'Union-Jack flottait en haut de la tour à côté du drapeau français, ce qui remontait le moral des soldats britanniques débarqués à Saint-Nazaire et rejoignant le front par la voie ferrée.
Lorsque le chef de gare des Forges savait à l'avance que le convoi devait stationner, il prévenait Mme PIRIE qui arrivait aussitôt sur le quai avec ses enfants chargés de victuailles diverses : c'était la joie dans le train et sur le quai d'entendre parler anglais. La paix revenue, la vie ne reprit pas comme avant. Les grandes propriétés terriennes subirent les conséquences de l'hécatombe humaine, très forte parmi les agriculteurs , et de la dévaluation des monnaies.
À la mort de son mari (Duncan Vernon PIRIE est décédé à Varennes le 11 janvier 1931, M. PIRIE ouvrit pour les jeunes filles de 17 à 21 ans une école pour apprendre le français, acquérir une connaissance pratique de la cuisine française, la théorie et la pratique du jardinage. Le nombre d'élèves était limité à 12. Cette initiative ne dura pas longtemps : 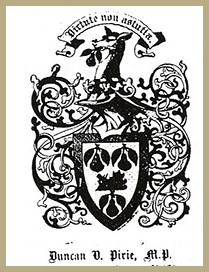 M. PIRIE décède à Varennes le 1er mars 1934 à 66 ans. Cet enseignement sera repris plus tard.
M. PIRIE décède à Varennes le 1er mars 1934 à 66 ans. Cet enseignement sera repris plus tard.
Les enfants de Duncan Vernon PIRIE sont au nombre de six : Evelyn Jean Gordon 1895-1981 (ancienne élève de l'école de Savennières) mariée à Owen WYNE. Patrick Taldo, 1897-1965. Alexander Alistair 1899-1993, marié à Annie RIDLEY RICHARDSON. Grizel Valentine, 1900-1978. Valérie Marguerite, 1906, mariée à Henry SPRY.
Douglas Gordon, né à Varennes en 1910, marié à Jean Frances CARMICHAEL. L'aîné des fils, Taldo, hérite de Varennes. Ancien élève du collège de Winchester, il est militaire de carrière de 1915 à 1947 dans les Gordon Highlanders. Combattant en France au cours de la première guerre mondiale, il reçoit la "Military cross". Il fait partie de 1930 à 1936 de la Sudan Defense Force et l’Equatorial Corps, puis de 1936 à 1938 il suit les cours de l'école de guerre à Paris. Arrivé en France dès la déclaration de guerre en 1939, il se trouve en juin 1940 à Dunkerque où il réussit à faire embarquer, en même temps, avec chaque soldat de son régiment, un Français.
Il termine la guerre en Italie puis en Allemagne. Il avait épousé le 25 novembre 1938, Christine Barbara, fille de Charles, Edward de LACEPEDE qui a relevé le nom de CAHILL.
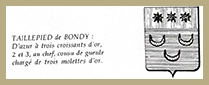 Ne pouvant résider à Varennes de par sa situation, de plus n'ayant pas d'enfant, le colonel PIRIE cherche une utilisation à cette grande propriété. Varennes va connaître une nouvelle étape avec l'arrivée de Mlle TROUARD-RIOLLE.
Ne pouvant résider à Varennes de par sa situation, de plus n'ayant pas d'enfant, le colonel PIRIE cherche une utilisation à cette grande propriété. Varennes va connaître une nouvelle étape avec l'arrivée de Mlle TROUARD-RIOLLE.
L'École Normale Supérieure Agricole et Ménagère de Savennières
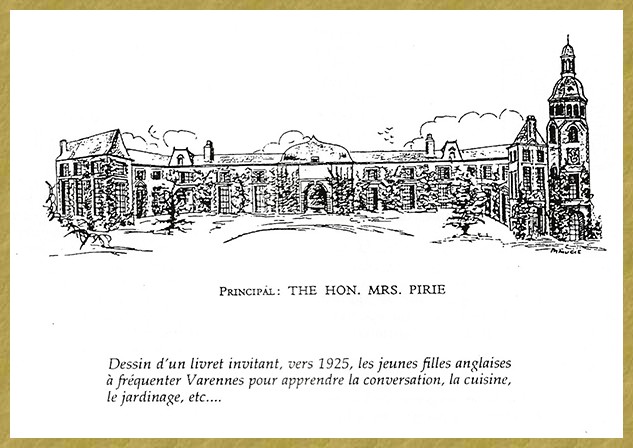
En 1938, sous l'égide d'un Syndicat d'enseignement rural créé par l'Institut de la rue Monsieur à Paris avec l'aide de l'École supérieure d'agriculture d'Angers (E.S.A.), s'ouvre l'Ecole normale supérieure agricole et ménagère à Varennes. La notice d'information indique les raisons de cette création « L'institut social familial ménager de la rue Monsieur à Paris se rendait compte qu'il lui était impossible de former, comme il le fallait, les jeunes filles appelées à se marier à la terre et à vivre en grandes fermières à leur sortie de l'Institut.»
En outre, l'extension des centres familiaux-ménagers à la campagne, exigeait des éducatrices spécialisées dans les sciences agricoles et ménagères, armées techniquement et moralement pour remplir ce rôle de première importance. Le choix des environs d'Angers pour créer cette école était motivé par l'importance de l'agriculture en Anjou et sa polyvalence (grande culture, fruits, vigne, graines, fleurs, élevages), mais aussi la présence à Angers depuis 1898 de l'Ecole Supérieure d'Agriculture et de Viticulture avec ses laboratoires, sa ferme expérimentale, son corps professoral et aussi ses élèves, disaient certains malicieux. Pour les candidates titulaires du baccalauréat, les études théoriques et pratiques duraient deux ans et étaient sanctionnées par un examen donnant droit au diplôme d'éducatrice familiale rurale et agricole.
La direction de l'École fut confiée en avril 1938 à mademoiselle Yvonne TROUARD-RIOLLE (1884-1968). Son père, ancien élève de l'école agronomique de GRIGNON, avait été appelé en 1905 pour prendre la direction de son ancienne école, ce qui permet à sa fille de côtoyer de nombreux scientifiques du monde agricole. Après son agrégation de Sciences Naturelles, elle est professeur au lycée Molière à Paris, participe à la création de la première École Supérieure d'enseignement agricole et Ménager de GRIGNON, plus tard transférée à Coëtlogon-Rennes, et donne des cours à l'institut Social Familial et Ménager.
À son arrivée à Varennes, «tout est à faire» : il y a huit élèves, on va traire dans l'étable de Monsieur le Maire. Voici comment Mlle TROUARD-RIOLLE elle-même raconte ce début en raccourci à sa façon : Après une causerie inaugurale, suivie d'une fervente prière à la chapelle, on emprunte à M. le Maire une poule, on achète des oeufs et l'on fit couver la poule qui donna 12 petits poussins. À trois mois, les poulets furent vendus au marché et ce fut le premier bénéfice de la ferme. En octobre 1938, une trentaine d'élèves remplit la maison.
Survient la guerre,douze fois, l'occupant chasse l'école des lieux qu'elle habite ; Mlle TROUARD-RIOLLE se réfugie dans des locaux de fortune. Douze fois avec sa ténacité habituelle, elle réinstalle le château de Varennes et la ferme-école en dépit des Allemands qui occuperont seulement une partie des bâtiments. Un saponarien raconte, qu'un soir la cour d'honneur est envahie par de nombreuses femmes réquisitionnées à Angers pour distraire et festoyer avec la troupe. Mlle TROUARD-RIOLLE et ses adjointes veillèrent toute la nuit en haut du grand escalier pour éviter des visites aux élèves.
Dès l'aube, elle se plaint à Monsieur le Maire, Bernard DU CLOSEL. Celui-ci d'origine, lorraine et sachant à qui il avait affaire, convoque à la mairie le jeune et distingué officier, chef du détachement, et en allemand lui dit à peu près ceci : "Monsieur, si cela s'était passé dans le château de Madame votre mère, elle ne l'aurait certainement pas accepté". L'officier blême de rage fit demi-tour sans rien dire, mais en claquant la porte. À la Libération, les bombes des forteresses volantes américaines et anglaises visant les ponts font trembler les vitres et les habitants tout en épargnant Varennes.
L'armée française occupe un temps les locaux. L'état des lieux, dressé après le départ des troupes en juillet 1944, fait état de nombreux dégâts : carreaux cassés, cuvettes fêlées, clés perdues, parquets très abîmés, électricité à refaire, chaudière de chauffage à remplacer. Les canons de marine qui ornent la terrasse sont encore en place. Ils ne disparaîtront qu'après la vente par la famille PIRIE, en même temps que les jardinières de fleurs en pierre ornant les piliers de l'entrée du parc. L'école ménagère réintégra tous les locaux, augmenta le cheptel avec des vaches bretonnes, des porcs et une centaine de volailles.
Le nombre d'élèves se monte à une centaine et Melle TROUARD-RIOLLE, en plus des cours de botanique, se fait libraire-éditeur pour son célèbre manuel " POUR PRÉPARER LE BONHEUR DE VOTRE FOYER " qui eut un gros succès auprès des jeunes filles des milieux ruraux dans toute la France. En 1948, le lieutenant-colonel Taldo PIRIE prend sa retraite. Avec son épouse Christine, il manifeste le désir de reprendre possession de sa propriété. L'école ménagère est transférée au château de la Beuvrière au Lion d'Angers. Les élèves de dix promotions seront donc passées par Varennes : toutes disent avoir été très marquées par la forte personnalité de Melle TROUARD-RIOLLE, sa vertu d'accueil et sa confiance en la Providence.
Pour finir, citons ce souvenir d'une ancienne élève de 40-42 : « les poissons rouges du bassin de Varennes distribués dans tous les lavabos des professeurs et de la Directrice un certain 1er avril nous avait valu un froid et silencieux mépris, mille fois plus éloquent et formateur aux convenances que la plus vertigineuse des semonces». Varennes reprit son aspect de résidence privée. Le colonel et Mme PIRIE firent remettre tout en état, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le parc fut entretenu, le jardin potager cultivé et la vigne produisit un excellent Savennières sous le nom de "Château de Varennes" vendu dans les bons restaurants de Londres et surtout en Ecosse. Les PIRIE aimaient recevoir ; beaucoup de saponariens se souviennent encore de la grande réception donnée à l'occasion du couronnement de Sa Majesté la Reine d'Angleterre Élizabeth II en février 1952. Le colonel paraissait alors avec le kilt écossais.
Étant alliés au clan GORDON, les membres de la famille PIRIE pouvaient en porter les couleurs. La maison était grande ; les frères et soeurs du colonel, les neveux venaient souvent revoir la propriété de leur enfance où certains étaient nés comme M. Douglas GORDON PIRIE, né en 1910 à Varennes, membre de la garde écossaise de la Reine, fier de son passeport français et de la Légion d'honneur reçue en récompense de services rendus à la France à Madagascar au cours de la seconde guerre mondiale.
Taldo et Christine PIRIE prirent aussi l'habitude de recevoir des jeunes gens de Grande Bretagne qui venaient apprendre le français, suivre les cours des écoles et universités d'Angers et, en été, les familles qui voulaient faire un séjour en Anjou. Matin et soir, les quais de la gare des Forges, à trois cents mètres de Varennes, résonnaient des échos de la langue de Shakespeare au grand étonnement des voyageurs de passage.
L'ère écossaise à Varennes prend fin : le colonel PIRIE décède à Varennes en 1965 ; son épouse Christine se replie dans l'aile gauche, le pavillon, mais rapidement se rend compte que l'entretien de cette grande propriété dépasse ses forces. Elle décide de vendre à un français, revenant du Maroc en ne conservant que le logement baptisé le "Petit Varennes" à l'ouest vers le moulin du gué. Quelques années avant son décès, en 1983, elle partit faire le tour du monde en bateau pour saluer les descendants des ROUSSEAU de La BROSSE émigrés en Nouvelle- Zélande à la fin du siècle dernier.
Suivant une vieille coutume familiale, lorsqu'un PIRIE quitte une résidence, les frères, soeurs et neveux du colonel PIRIE en souvenir de leur long séjour à Varennes (un siècle), ont créé une bourse pour payer chaque année à un jeune de Savennières de 16 à 20 ans le prix du billet d'avion pour Édimbourg.
Les seules conditions sont d'avoir un correspondant en Ecosse qui peut vous recevoir au moins trois semaines et, en échange, accueillir, le même temps, en France un jeune Écossais. Ainsi, les très vieilles relations France -Ecosse remontant à l'an 1295 et dont l'association "The Auld Alliance" fête cette année le 700e anniversaire pourront se perpétuer à Savennières.
À l'aube du XXIe siècle Après le départ de la famille PIRIE, plusieurs propriétaires se succèdent à Varennes. Les divers bâtiments, le Vieux Varennes, le pavillon, le château, la ferme, le cellier, les deux loges aux entrées du parc, le coteau deviennent des résidences avec des statuts juridiques variés : pleine propriété, copropriété, société, groupement foncier. Le grand clos de vigne est replanté ainsi que d'autres parcelles exploitées par des viticulteurs voisins ou des sociétés.
Varennes perd son caractère de grande propriété agricole et familiale mais conserve, grâce à la belle ordonnance de ses bâtiments et à la beauté de ses arbres et de son parc tout le charme et l'élégance des vieilles demeures françaises. Elle reste une très belle parure du patrimoine des coteaux de Loire-e- Maine.
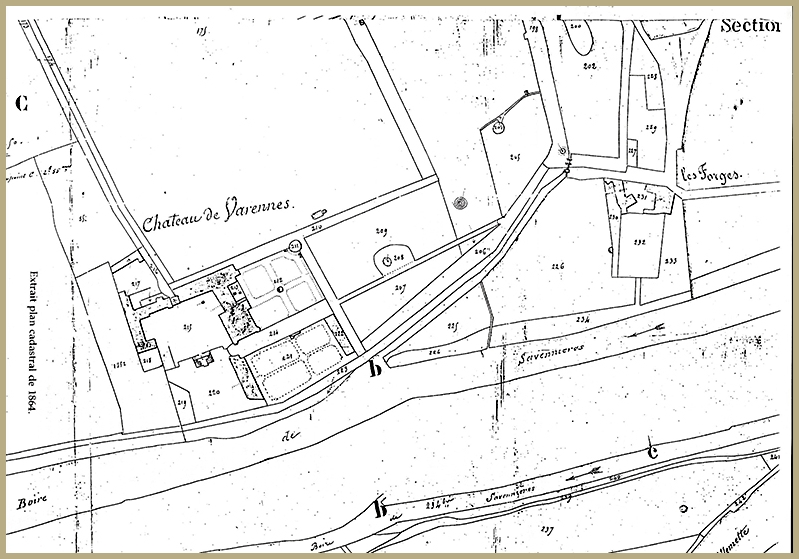
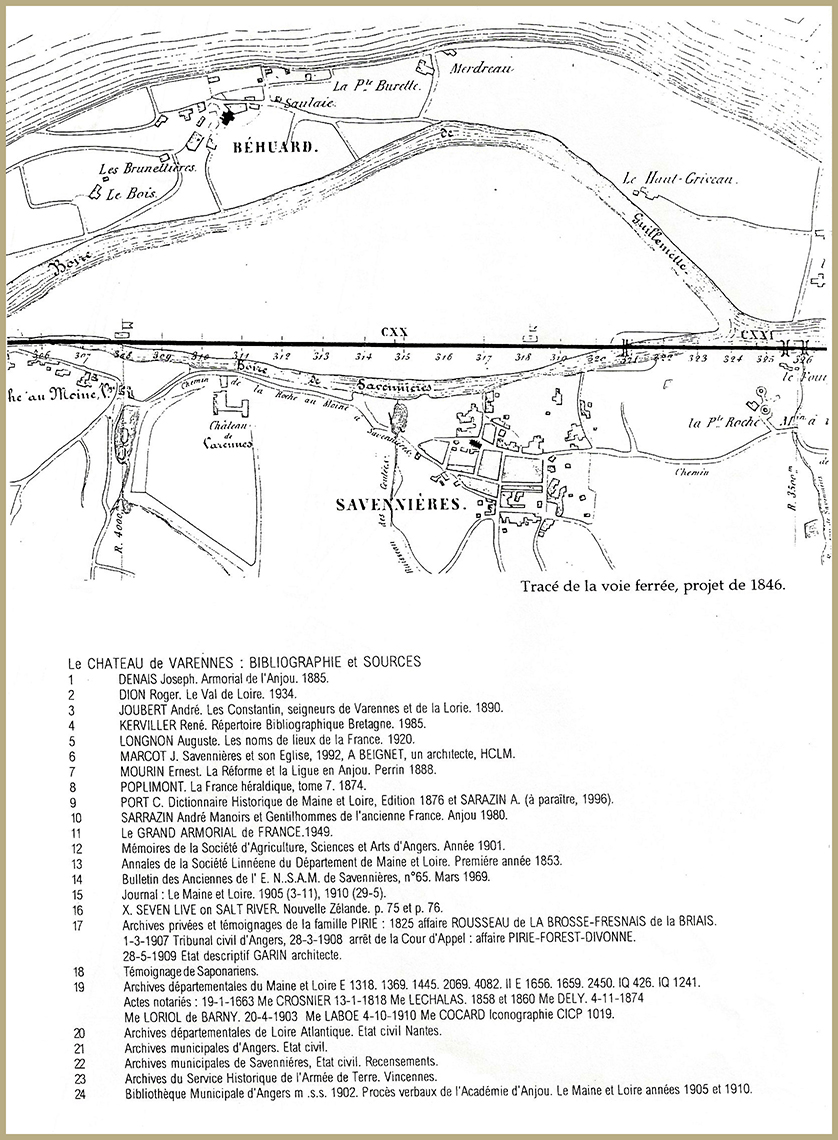
Histoire du Parc de Varennes
Le parc de Varennes a été créé entre 1820 et 1860, les propriétaires de l'époque étant la famille ROUSSEAU de la BROSSE. Les plus gros arbres actuels doivent donc avoir environ 150 ans ; c'est le cas des 25 cèdres de l'Atlas, des 15 cèdres de l'Himalaya, des 20 plus gros chênes pédonculés et d'une ancienne allée de charmes.
En 1864, le parc présentait le tracé actuel à part quelques détails : l'aile droite du château avançait vers le sud en ne laissant qu'une allée surplombant le potager et celui-ci était flanqué de bâtiments étroits qui le protégeaient encore mieux. À cette même époque, le canal dit « la Boire » avait la même largeur et la même forme qu'au cadastre actuel. De 1874 à 1901, Varennes est propriété de M. Gordon PIRIE, riche industriel écossais, beau-frère de M. ROUSSEAU de La BROSSE. Il entreprend des transformations, surtout au château, l'aile droite reconstruite par l'architecte angevin BEIGNET sur les mêmes fondations, mais en style écossais. C'est peut-être aussi de cette époque que datent l'allée de buis (qui aurait donc environ 120 ans) et le petit tunnel (une fabrique de l'époque), ces 2 éléments ne figurant pas au plan de 1864.
De 1901 à 1931, le propriétaire est son fils, le lieutenant-colonel Duncan Vernon PIRIE. Grand voyageur, passionné par les nouvelles espèces d'arbres et d'arbustes que l'on découvrait à l'époque, celui-ci va entreprendre une collection, comme nous le verrons plus loin. En 1905, un incendie ravage l'aile droite écossaise du château. On la reconstruit plus petite, d'où la création d'une grande terrasse dominant le potager.
On en profite probablement pour y planter les 5 marronniers qui ont donc environ 80 ans ainsi que le grand magnolia de Delavay et le grand arbousier hybride qui sont adossés à l'aile droite actuelle.
À partir de 1903, et surtout de 1903 à 1920, Duncan Vernon PIRIE crée son arboretum autour du château et dans l'ancien potager. Il fait venir des espèces nouvelles ou récentes d'arbres et d'arbustes de Chine, du Japon, d'Afrique, de Californie, du Chili, etc, directement ou par l'intermédiaire de Kew Gardens en Angleterre, pour les acclimater à Varennes. La cour du château et l'ancien potager dit « jardin chaud » sont particulièrement abrités, dans un microclimat déjà exceptionnel. Monsieur PIRIE recherche surtout les arbres et arbustes rares, "frileux" et si possible odorants.
Dès 1901, il plante un olivier qui fructifie en 1925 et qui existe toujours sous forme d'une repousse. De 1920 à 1929, un bananier (Musa Bas-joo) fructifie et donne une récolte presque tous les ans. En 1928, un inventaire nous indique 160 espèces rares d'arbres et d'arbustes, dont 30 subsistent de nos jours.
En 1929, l'Holboellia (aux repousses toujours actuelles) tapisse tout un pan de l'aile droite du château. Entre 1929 (après un gel qui fit beaucoup de dégâts) et 1931, de nouvelles plantations sont encore effectuées (dont probablement les chèvrefeuilles arbustifs et autres arbustes qui auraient donc environ 65 ans.) En 1931, à la mort de Duncan Vernon PIRIE, Varennes est le deuxième arboretum de l'Anjou après celui de Gaston ALLARD, l'Arboretum actuel d'Angers. Duncan Vernon PIRIE et Gaston ALLARD entretenaient d'ailleurs des relations et s'échangeaient des végétaux.
De 1939 à 1991, le parc se dégrade lentement. Après la 3e génération de la famille PIRIE, le château change plusieurs fois d'occupants et finit par être une .copropriété, telle que nous la connaissons actuellement. En 1991, on commence le nettoyage et la remise en état du parc. En 1992 et 1993, la Société d'Horticulture d'Angers réalise l'inventaire botanique du parc avec le soutien d'un des copropriétaires et l'acceptation des autres. Le rapport d'inventaire comporte près de 300 arbres et arbustes intéressants appartenant à 120 espèces.
En 1994, enfin, nous procédons à l'étiquetage de 200 arbres et arbustes.
Description du Parc Actuel
Le parc de Varennes peut se définir comme un parc de charme, où il fait bon se promener au travers des vestiges d'un arboretum du début du siècle. L'amateur d'art remarquera le château, la cour, le porche, la tour octogonale, la chapelle, les caves. Le promeneur romantique rêvera au cours d'une longue promenade sous de beaux cèdres bleus, puis au bord de l'étang, dans le chemin creux et dans l'allée de buis avec des échappées sur les vignes. Le botaniste dendrologue pourra étudier des essences rares dont certains spécimens ont été non sans peine identifiés.
Des Plantes Rares
Nous ne pouvons pas ici entrer dans les détails de cette ancienne collection et énumérer des espèces dont les noms botaniques en latin rebuteraient le lecteur. Nous userons le moins possible de ces noms botaniques.
Citons seulement :
Des Plantes Rares Chèvrefeuille chinois arbustif, Magnolia chinois de Delavay (un des premiers introduits en France), Orme austral du Chili, Chênes-lièges, Feijoa, Garrya, Poliothyrsis.
De Beaux Ensembles
Une merveilleuse allée de buis de 200 mètres, une haie d'orangers trifoliolés, les vestiges d'une allée de charmes.
Des Tailles Respectables Cèdre de l'Atlas de 35 m, Marronnier de 27 m, Kaki et Houx de 17 m et Arbousier de 13 m,
Des Troncs Vénérables Cèdre de l'Atlas de 4,30 m, cèdre de l'Himalaya de 4m.
Des Essences Frileuses.
Ces plantes ne seraient pas assez rustiques pour le climat parisien, par exemple : Arbousiers, Camélias, Chênes-lièges, Coriaria, Feijoa, Figuier, Grenadiers, Kakis, Magnolia de Delavay, Olivier, Palmiers, Viorne odorante. Des plantes à la floraison remarquable : Abélia, Arbousier, Calycanthes, Cerisier japonais, Chèvrefeuilles arbustifs, Chimonanthes, Clérodendron, Jasmin-primevère, Kolkwitzia, Magnolia étoilé, Seringat, Spirées et Virgilier.

Vaults (Vaulx)

En plein coeur du village, le château des Vaults abrite un des plus anciens et des plus importants domaines viticoles de Savennières. À la fin du XVe siècle, le domaine faisait partie du fief de la seigneurie des Vaults avec son vignoble, son verger et son jardin.
Il était alors simple logis du Seigneur de Vau. Le château fut construit au XVIIe siècle, puis remanié et agrandi au XIXe avec l'adjonction de deux pavillons latéraux. Le vaste parc paysager, tel qu'il existe aujourd'hui, est d'une grande richesse variétale. Il fut créé vers 1850 ainsi que le potager et le petit pont qui enjambe la route du village et qui permet d'accéder au vignoble sur le coteau.
Le domaine fut dès le XVIIe siècle la propriété d'éminents personnages de la haute bourgeoisie angevine, puis de la prestigieuse famille d'armateurs nantais, les Walsh, comtes de Serrant.
Plus tard, au XIXe, la famille d'Emmanuel de Las Cases, biographe de Napoléon, hérita du domaine. Depuis cette époque, le château des Vaults et ses vignes (Domaine du Closel) sont gérés par les descendants de cette famille. Une lignée de femmes vigneronnes est née, commençant par Marquerite de Las Cases, épouse du Closel.
Sa nièce, Michèle Bazin de Jessey développa le vignoble et créa la société d’exploitation , Les Vins Domaine du Closel à laquelle elle associa ses deux enfants. C’est actuellement sa fille, Evelyne de Pontbriand, qui dirige la propriété et qui a beaucoup développé les activités œnotouristiques au château, l’export et qui a converti le domaine en agriculture biologique et maintenant biodynamique.
Remaniés à plusieurs reprises sur des bases anciennes, les bâtiments actuels datent de la fin du siècle dernier, et le parc, qui leur constitue un très bel écrin de verdure, a été transformé après le passage de la ligne de chemin de fer qui, malheureusement, barre la vue du Sud. Au début du XIXe siècle, le vieux cimetière de Savennières occupait encore la moitié de la place actuelle derrière le château ; au-devant se trouvaient les parterres à « la française », puis le jardin anglais et enfin la boire de Savennières, beaucoup plus large qu'aujourd'hui.
À l'Est, le ruisseau des Coulées alimentait un lac avec une île près de la route d'Angers. On disait alors le château des Veaux, mais l'orthographe actuelle pluriel de val (vallon, vallée) est la bonne.
Source : Histoire souvenirs des Coteaux de Loire et de Maine
Le Parc des Vaults : Domaine du Closel
C'est un parc paysager agreste et viticole dessiné sous le Second Empire dans un esprit romantique, au goût du jour, créant un endroit à vivre et à travailler. Le foin des prairies, les légumes du potager et les vignes des coteaux y font régner une ambiance champêtre, parfois encore un peu sauvage, bien que très naturelle, et où l'agriculture tient toujours sa part. La construction de la voie ferrée au milieu du siècle dernier a permis d'intégrer un beau plan d'eau constitué par une boire, ancien bras de Loire qui arrosait jadis le port de Savennières et qui était canal navigable. Elle est également alimentée par les eaux limpides d'un ruisseau qui sourd au milieu de rochers près d'un platane gigantesque.

Le parti d'aménagement fut la courbe et la contre-courbe pour les circulations qui enjambent le ru et l'étang sur des petits ponts. Ainsi, tout en admirant les très grands et très beaux arbres : chênes séculaires, platanes, cyprès chauves, marronniers, séquoia semper virens etc., on se laisse conduire insensiblement vers le vignoble des coteaux en franchissant la route sur une puissante arche de pierre, sorte d'arc de triomphe aux portes du bourg. On revient en longeant la boire par une allée ombragée après avoir pris le temps d'admirer la variété et la qualité des points de vue.
On remonte alors vers le potager, élément important du décor où fleurs, fruits et légumes font bon ménage à l'ombre du clocher signalant la présence d'une des plus vieilles églises de France. On peut terminer la promenade par la dégustation de vins prestigieux.
Autour du logis, la flore exprime la douceur du microclimat local qui permet l'acclimatation de plantes exotiques comme le chimonantus, le citrus poncirus trifoliata. En hiver, les jasmins à fleurs jaunes (nudiflorum et mesnyi), les camélias, hellébores, plaqueminier (kaki), actinidiers (kiwi) éclairent la grisaille du temps, laissant place bientôt aux bulbes, à un rosier très précoce (talisman), puis aux glycines, lilas, aux iris et aux pivoines.
La préciosité des roses contraste avec la simplicité des prairies naturelles aux mille fleurettes et les pétunias, géraniums, sauges, anémones du Japon et autres fleurs à bouquet prennent la relève.
À l'automne, les somptueux feuillages des grands arbres accompagnent les vendangeurs dans les vignes qui flamboient aux derniers rayons de l'été. Ainsi vit ce parc au rythme des saisons pour notre enchantement, le respect de la nature et l'embellissement de nos coteaux de Loire.
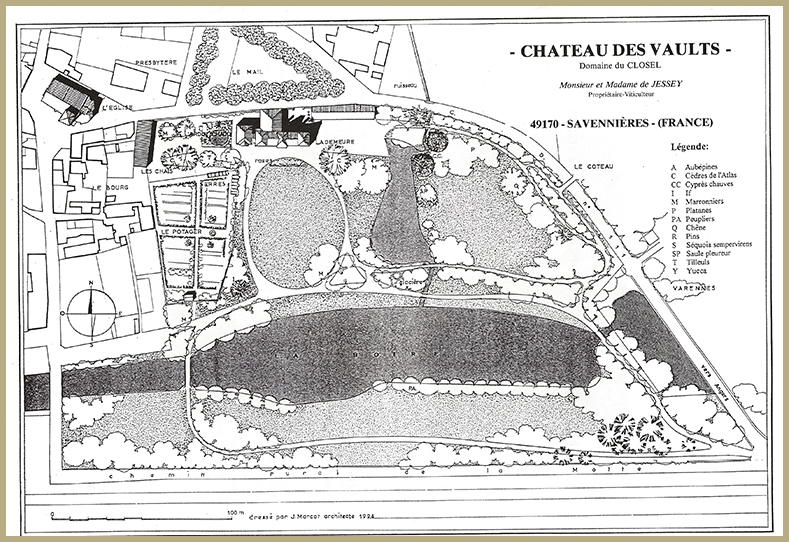

MANOIRS et LIEUX-DITS DE SAVENNIERES
Andillé
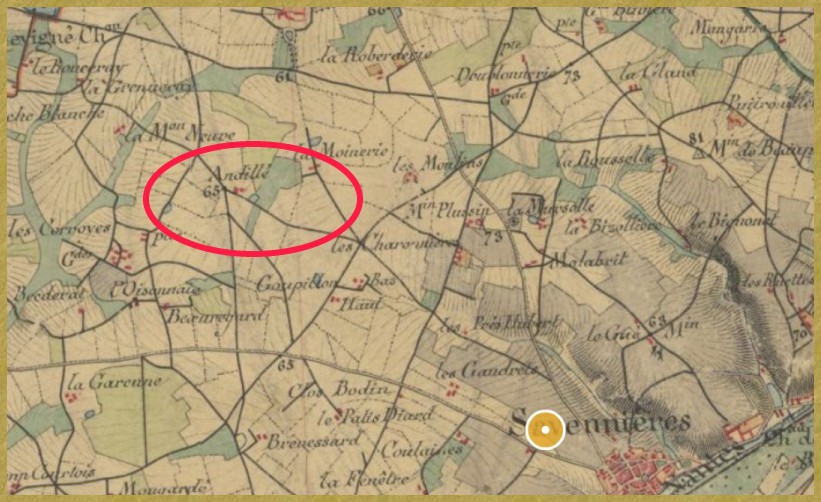
Sur la paroisse de Savennières, donné par Charles-le-Chauve à l’abbaye de Saint-Florent le 23 juillet 848 en même temps que Iohannis villa, Canciacus (Sainte-Gemmes-sur-Loire) et Nimiacus (non localisée), a été publié en Tessier no 109.
Les relevés de ces actes ont été réunis par Josiane Barbier dans sa thèse dactylographiée de Lille 1994, Palatium, fiscus, saltus, recherches sur le fisc entre Loire et Meuse du VIe au Xe siècles, et présentent un intérêt éminent quant au peuplement de certaines régions étudiées.
Mais la fréquence faible des interventions du fisc dans cette partie de l’Anjou, surtout en la comparant au Baugeois ou au Sud Loire, incite à croire au faible peuplement et au déboisement de ces régions. Andillé, sur Savennières, domaine dépendant peut-être de Iohannis Villa, fait une notable exception à cette remarque. De plus, ce site est le seul lieu appartenant au fisc qui n’a pas connu de développement urbain, même modeste. Il ne comprend sur le cadastre ancien qu’un seul habitat.
Cette remarque pousse à considérer cette localisation avec la plus extrême prudence. La présence du fisc est encore attestée à Andillé, dépendance de Iohannis Villa, cédée le 23 juillet 848 par Charles-le-Chauve à l’abbaye Saint-Florent. La localisation de Iohannis Villa est incertaine malgré de nombreuses hypothèses. L’autre dépendance, Canciacus, a pu être localisée sur le site de l’actuelle Baumette, sur la rive gauche de la Maine à quelques kilomètres au sud d’Angers. Dès lors, Andillacus, peut-être située à Andillé sur la commune actuelle de Savennières.
Le dessin du parcellaire , la situation à proximité de la voie romaine vers Nantes et la toponymie rendent crédible cette hypothèse. Il n’est pas fait mention d’une église dans le texte qui précise ac terris, vineis, silvis, pratis, acquis, molendinis aquarumque decursibus vel quicquid eadem pertinere videntur.
La terre cédée n’est pas vierge d’habitat et d’aménagements, sans qu’il soit possible d’affirmer que cette énumération concerne uniquement et totalement Andillé.
Source : Doyenné de Candé par Michel PECHA
Andillé,( par Célestin PORT)
Antique villa, réunie dès le XIe siècle au domaine de Savennières. Elle appartenait alors à Rainulfe, chevalier, qui la tenait de Rainier et Hubert de Villiers, ses suzerains, et plus tard de Bardon de Chantocé. Une partie avec des bois en fut donnée à Saint-Maurille de Chalonnes, et le manse seigneurial au Ronceray. Maurice de Saint-Quentin, qui avait le droit d'y faire élever un cheval chaque année, dégagea l'abbaye de cette servitude.
La terre relevait encore au XVIe siècle de la seigneurie de Savennières par l'intermédiaire du fief de Lavau. C'est une simple ferme aujourd'hui, sans aucune trace ancienne, que deux monticules, dits la Grande et la Petite-Motte, dont le sol factice se nivelle chaque année.
Les Lauriers

Demeure de plaisance du Val-de-Loire construite au cours du premier quart du XVIIIe siècle. Son parc comprend un jardin à la française, un jardin de topiaires, un mail de tilleuls, des bosquets et une roseraie. François Poulain de la Foresterie, maire d'Angers et amateur de jardins (il fait replanter et orner d'arcades le grand mail d'Angers en 1707) achète plusieurs maisons de la rue des Quatre-Œufs.
Lui-même, puis son fils, Charles Poulain de Bouju, professeur de droit canon à l'Université d'Angers, entreprennent alors la construction d'une demeure de plaisance.
Un premier corps de bâtiment fut bâti d'abord en bordure de rue, puis, celle-ci ayant été acquise après négociations avec les habitants de Savennières, une cour d'entrée fut créée, ouvrant sur la rue de la Barrière-Benoist (de nos jours rue Beau-Soleil), avec pressoir et cellier en retour d'équerre du côté nord. La propriété ainsi constituée reçoit alors le nom de « Les Lauriers ».

M. Poulain de Bouju vend Les Lauriers le 2 juin 1723 à un gentilhomme allemand, Jean-Pierre de Swinford, natif de Heidelberg, en Palatinat, converti au catholicisme depuis trois ans et qui, peut-être venu à Angers comme beaucoup de ses compatriotes pour fréquenter notre célèbre Académie royale d'équitation, y avait épousé Catherine Joly des Hayes. Dès l'année suivante, en 1724, il obtiendra ses lettres de naturalité française et il continuera l'embellissement des Lauriers en ajoutant le grand pavillon à fronton central, vers le sud, donnant sur des jardins français en terrasses et « ayant son aspect sur la rivière de Loire ».
Âgé de 81 ans, M. de Swinford cède en 1745 la propriété à Maitre Jacques Duboys. Maitre Jacques Duboys, recteur de la Faculté de Droit d'Angers plaide et publie en 1754 un mémoire contre les « collecteurs d'impôts, paroissiens, manants et habitants de Savennières », il est également en guerre tantôt froide, tantôt déclarée avec ses collègues de la Faculté.
Dès 1756, Les Lauriers sont vendus par adjudication. Perrine Pélagie Cassin, veuve du chevalier de Goué de Clivoy l'achète alors, puis les Lauriers reviennent à la famille Romain qui, le 30 août 1785, la céderont à quatre frères et sœur, Joachim, Jean, Joseph et Marie-Françoise Trottouin, négociants à Angers, qui la revendront sept ans plus tard, le 23 novembre 1792, à Jacques Gastineau, professeur de droit, membre puis directeur de l'Académie royale des sciences et belles lettres et arts d'Angers.

Sa fille, Mme Doublard du Vigneau, vendit Les Lauriers le 7 vendémiaire de l'an V à Louis Tardif de La Chaumerie, Conseiller du roi, Procureur au contre mesurage des sels. Plusieurs familles se succéderont, en particulier la comtesse de Gramont de Coigny qui ajoutera le beau portail d'entrée, puis le duc de Cadaval, son petit-fils. En 1971, Robert et Violette Cointreau acquièrent Les Lauriers. Ils créeront notamment une roseraie en agrandissant la propriété vers le Sud. En 1974, les façades et toitures du manoir, ainsi que les jardins, sont inscrits aux monuments historiques.

Les Fosses noires
Section B3 en bordure d’Epiré, parcellaire quadrangulaire alors qu’il est plus lanièré, à l’ouest. Le toponyme est au centre d’un triangle déterminé par la route de la Petite Rosselle et celle d’Epiré à Savennières,
Source : Wikipédia
Les Fosses neuves
Ou fossés neufs (orthographes variables). En C5, cadastre de la commune actuelle de La Possonnière, mais celle ancienne de Savennières. C’est un ensemble de parcelles formant un dessin ovoïde orienté nord-sud au milieu d’un parcellaire quadrangulaire orienté est-ouest. Cet ensemble est bordé d’un chemin au nord et à l’ouest.
La surface est d’environ 2000 m2. Les Fosses « Pourry » sont indiquées sur l’état des sections servant de base à l’imposition, mais on ne les retrouve pas sur le cadastre napoléonien sous le toponyme de Pourry. Ce bois de la Fosse ou Fosche Pourry (ou Fosche Porry) ou encore selon, Y. Mailfert « Touche Pourry » aurait été donné à Saint-Nicolas par Matthieu du Plessis et confirmé par Geoffroy-le-Bel en 1136, acte entre 1126 et 1129.
Haies ou Hayes
À l’est de la commune, en bordure de la voie ferrée et d’un ancien bras de la Loire en cours de disparition. Le parcellaire a été bouleversé à la période contemporaine. Il existe cependant une indication dans le cartulaire du Ronceray en 1028 avec l’indication de Forgiae. Le site est donc dévolu à la métallurgie. Pourtant, il n’existe pas de filon ferrugineux à cet emplacement, seulement de l’autre côté de la Loire vers Chalonnes et le long de la faille du Layon. La zone est encore assez boisée. Elle est proche du promontoire de la Roche-aux-Moines qui abrita le château du même nom au début du XIIIe siècle.
Forges (Les)
À l’est de la commune en bordure de la voie ferrée et d’un ancien bras de la Loire en cours de disparition. Le parcellaire a été bouleversé à la période contemporaine. Il existe cependant une indication dans le cartulaire du Ronceray en 1028 avec l’indication de Forgiae.
Le site est donc dévolu à la métallurgie. Pourtant il n’existe pas de filon ferrugineux à cet emplacement, seulement de l’autre côté de la Loire vers Chalonnes et le long de la faille du Layon. La zone est encore assez boisée. Elle est proche du promontoire de la Roche-aux-Moines qui abrita le château du même nom au début du XIIIe siècle.

Les MOULINS DE SAVENNIERES
Moulin de Beaupréau
De ce lieu, on découvre un des plus beaux horizons de l’Anjou.
Étymologie Beaupréau,
C'est le beau pré, ou plus précisément la belle prée. Le mot pratellum, que l'on trouve dans la première forme ancienne, vient en effet du latin pratulum, diminutif du latin pratum, « pré ». Jusqu'au XVIIIe siècle, le mot pré se déclina aussi au féminin : la prée était une vaste prairie à l'intérieur de laquelle le bétail pouvait paître durant plusieurs semaines. Dans le glossaire d'Henri Cormeau, « la prée est égale en surface à plusieurs prés ».
Associés à différents adjectifs, les mots latins pratum, et son pluriel prata, ont donné de nombreux noms de lieux : Pralom (Loire) qui désigne un pré long, Pratvie (Tarn) qui signifie vieux pré, Prénovel (Jura), que l'on peut traduire par nouveau pré, Praslay (Haute-Marne) par pré large, Pralognan (Savoie) qui veut dire pré éloigné. En 1672, Ménage écrivait au sujet du mot prée qu'il était « autrefois fort en usage ; nous le disons encore en Anjou où nous mettons la différence entre pré, prée, prairie. Nous appelons un pré : un petit pré ; une prée, un grand pré qui est enclos ; une prairie, une grande commune sans clôture, le long d'une rivière. Mais on ne dit plus «prée», ni à la Cour, ni à Paris.
Même si le mot prée est aujourd'hui tombé en désuétude, de nombreux lieux-dits conservent son souvenir dans la toponymie angevine. C'est ainsi que l'on trouve le hameau de Juigné-en-la-Prée entre Daumeray et Morannes, dont la forme ancienne de 1134 était Prioratus de Juinniaco de la Prata. À Montreuil-Bellay, un mégalithe est situé à la Grande Prée de Thouars. Du côté de Longué, on trouve la Prée-des-Essarts, la Basse-Prée, la Prée-des-Buteaux et la Prée-des-Montils. À Chênehutte, le village des Tuffeaux s'appelait en 1790 Notre-Dame-de-la-Prée. Les terrains le long de la Loire, au-dessus de Drain, s'appellent la Basse Prée et la Grande Prée.
Et en contrebas de la corniche angevine, entre Rochefort et Chalonnes, l'aviateur René Gasnier accomplit ses premiers vols en septembre 1908 sur les terrains de la Grand Prée à Saint-Aubin-de-Luigné (on remarquera que l'adjectif est masculin bien que le nom soit féminin, comme dans les mots grand-mère, grand-chose ou grand-messe). À Angers, on jouait jadis au mail (sorte de croquet) à l'emplacement de l'actuel jardin du Mail, mais aussi sur la Prée-d'Allemagne située à proximité.
À Nantes, c'est dans la Prée de la Madeleine que Gilles de Rais fut brûlé vif le 26 octobre 1440 comme assassin, sorcier, faux-monnayeur, sodomite et athée.
Moulin du Fresne ou de la Petite Roche

Le moulin du Fresne (ou de la Petite Roche) est un moulin à vent cavier, caractéristique en Anjou, élevé au XVIIIe siècle et doté d'ailes à entoiler ; le meunier entoilant ou désentoilant chaque aile. Le moulin-cavier est un type de moulin à vent se composant d'une maçonnerie conique (massereau) construite au-dessus d'une cave, et d'une cabine mobile en bois (hucherolle) porteuse des ailes et d'une échelle-queue.
Le massereau est la maçonnerie conique construite au-dessus de la cave, traversée par un pivot en bois reliant le mécanisme de la hucherolle aux meules. La hucherolle est la cabine en bois mobile, presque cubique, portant les ailes et une échelle-queue, et dans laquelle on trouve les engrenages de renvoi du mouvement des ailes.
Historique Siècle de la campagne principale de construction 2e moitié 17e siècle
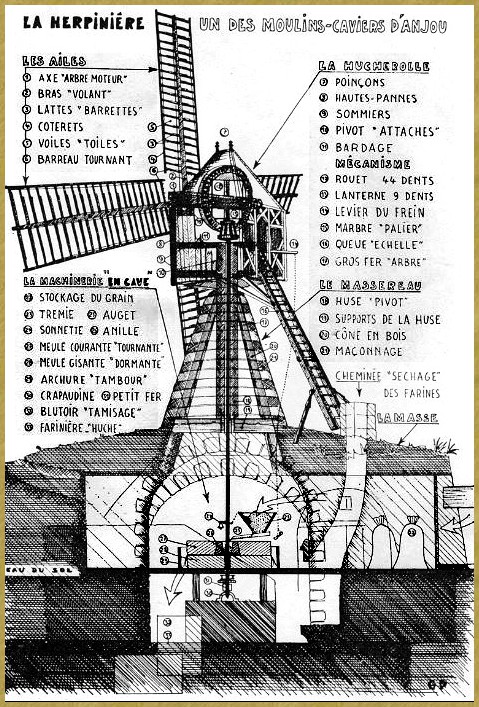
Le moulin de la Roche, ou de la Franchaie, qui relevait autrefois de la seigneurie de Serrant, fut construit au cours de la seconde moitié du 17e siècle ; il ne possédait alors qu'une seule paire de meules et sa voilure était en toile. Vers 1860-1870, il fut rehaussé et reçu des ailes à planches du système Berton, deux paires de meules et un régulateur de Watt. Il cessa de fonctionner en 1914 et fut restauré et remis au vent en 1980. Sa tour, en schiste ardoisier, mesure 8 mètres de hauteur et 6 mètres de diamètre ; le mur est de 90 centimètres d'épaisseur à la base et de 70 au sommet. Elle a été ceinturée de deux frettes métalliques en 1906. L'arbre moteur, de 6,20 mètres de longueur, est en chêne et est incliné de 13 degrés par rapport à l'horizontale. Les verges de 15 mètres d'envergure portent une voilure en planches de pin d'Orégon, d'un centimètre d'épaisseur, dont la surface maximale est de 52 mètres carrés.
Les deux paires de meules sont situées au deuxième étage, sous la coiffe et le moteur éolien. Le premier étage abrite la distribution du mouvement aux meules par un hérisson et deux couronnes, ainsi qu'un blutoir. L'ensachage s'opère au rez-de-chaussée.
Source : Ministère de La Culture
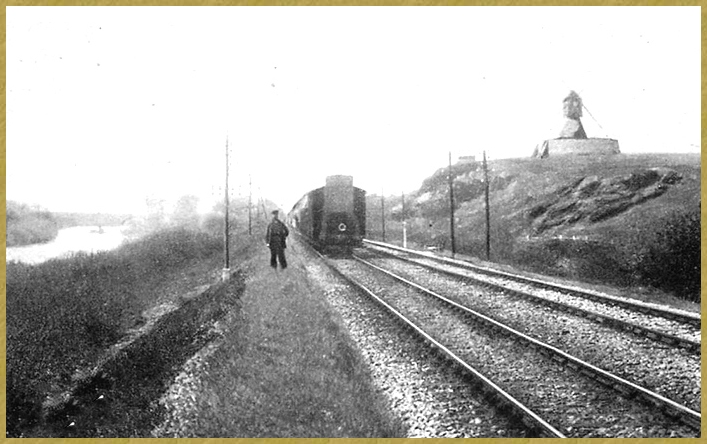
Louis Coraboeuf menait également le moulin voisin du Fresnes situé à 1 km à peine plus à l'ouest. Après son décès en 1873, son neveu Pierre prit sa suite. Il y resta jusqu'en 1906, alors qu'en 1893 le moulin avait été soustrait du domaine de Serrant.
Après 1906, c'est Joseph Bouin, neveu de Pierre Coraboeuf qui prit la suite, jusqu'en 1912, date à laquelle le moulin fut abandonné.
Ce n'est qu'à la fin des années 1970 que, à l'initiative de son propriétaire M. de Villaret et avec l'aide de l'association des Amis des Moulins d'Anjou, on envisagea sa remise en état. L'entreprise fut menée à bien en 1979 par l'entreprise Croix de la Cornuaille.
Le mécanisme de 1860 a été conservé, l'arbre, les ailes, la queue de mise au vent et la toiture ont été refaits sous les mains expertes de son nouveau meunier Eudes de Villaret. Il tourne désormais souvent au vent, écrasant des céréales secondaires pour les animaux de son exploitation ou du blé donnant une farine dont le boulanger de la commune fait de savoureuses Possonnettes. Mais ce n'est plus qu'un monument historique, fleuron de notre écomusée local.
Source :La Possonnière au XXe siècle
Le moulin de la Petite Roche est l'un des derniers moulins raviers d'Anjou, heureusement bien restauré.
Il est le plus occidental et le plus proche de la Loire, la dominant fièrement du haut de son rocher. Le passage du fleuve à cet endroit est le plus dangereux de tout son cours. Est-ce pour cela qu'à côté, le chemin séparant les deux communes de Savennières et de La Possonnière conduit de l'Enfer au Paradis ?
Moulin de Plussin
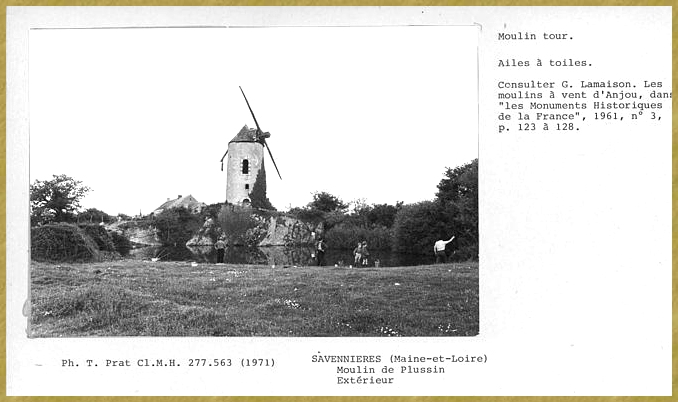
Situé au milieu d'une propriété privée, le moulin de Plussin à Savennières se situe sur un éperon rocheux en bordure d'une mare. Dépourvu d'ailes, sa toiture en ardoise est en bon état et l'entrée de l'arbre de couche est protégé des intempéries. Les encadrements de fenêtres sont alternés de tuffeau et de briques.

Le moulin de Plussin est un moulin à vent à haute tour et doté d'ailes à toiles. La porte basse est peut-être du XVIIe.
Les ouvertures supérieures montrent une restauration ou une surélévation au XIXe siècle. C'est le plus ancien des trois moulins-tours de Savennières, qui datent du XIXe, les moulins du Gué, de Beaupréau et de Plussin.
Dans les années 1970, il est encore équipé d'ailes traditionnelles. Le moulin-tour est un type de moulin à vent se composant d'ailes, d'une toiture conique orientable et d'une tour en maçonnerie. La machinerie et les meules sont placées dans la tour. L'édifice est un patrimoine protégé, inscrit aux Monuments historiques par arrêté du 12 décembre 1975.
Moulin de type tour (énergie éolienne). Il est la propriété d'une personne privée. Localisation : Moulin de Plussin, chemin des Charronnières, lieu-dit Les Charronnières.
Source :Wiki Anjou
Moulin du Gué ou Montsouris
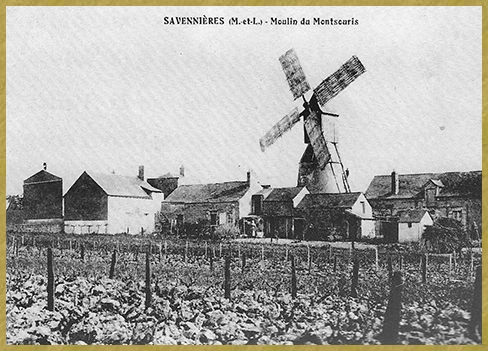
Le «moulin du Gué», était déjà signalé sur la carte de Cassini (1760-1780). Au début de XXe siècle, nous le retrouvons appelé selon le goût du jour, moulin du Gué, moulin de Montsourg, moulin de Montsouris ou Monsouris, venant tous deux de «Moque-souris», comme on l'appelait en 1894.
En 1864, le moulin était toujours en activité. Sans doute très vétuste, il fut démoli en 1867. Il n'en reste aujourd'hui que la masse imbriquée dans les maisons.
Au village du Gué tournaient deux moulins, tous deux caviers ; le premier disparut au siècle dernier. Le second, dit encore le moulin de Mausouris, perdit d'abord ses ailes, puis sa hucherolle, petite cabine de bois pour ne laisser dominer les toitures et des vignes que son cône en forme de bouteilles. Le moulin cavier est un moulin à vent caractéristique en Anjou, en particulier dans le Saumurois. Il est composé d'un corps mobile appelé « hucherolle », supportant les ailes et contenant uniquement le mécanisme de renvoi du mouvement.
La hucherolle repose sur une maçonnerie conique construite au-dessus d'une cave, parfois troglodytique, à l'intérieur de laquelle se trouvent les appareils de mouture, ce qui explique l'appellation de « moulin cavier ».
La hucherolle est la cabine en bois mobile, presque cubique, portant les ailes et une échelle-queue, et dans laquelle on trouve les engrenages de renvoi du mouvement des ailes.
Source : Wiki-Anjou

page suivante =Developpement de Savennieres
page precedente = Origine de Savennieres


